Quand des somnambules s’en vont déclarer la guerre …
Si l’on veut que nos enfants comprennent pourquoi cette catastrophe a eu lieu, il faut être prêt à débattre des origines de la guerre. Si c’est pour aller dans un cimetière et se lamenter sur le sort des victimes, alors les commémorations n’auront servi à rien. Je trouve cela déprimant que la France soit si réticente à engager un débat sur les responsabilités de la guerre. Apparemment, les historiens français n’ont absolument pas envie de s’aventurer sur ce terrain. Il me semble qu’il y a une grande peur de réveiller les hostilités avec l’Allemagne. » Le point de vue de l’historien britannique Max Hastings
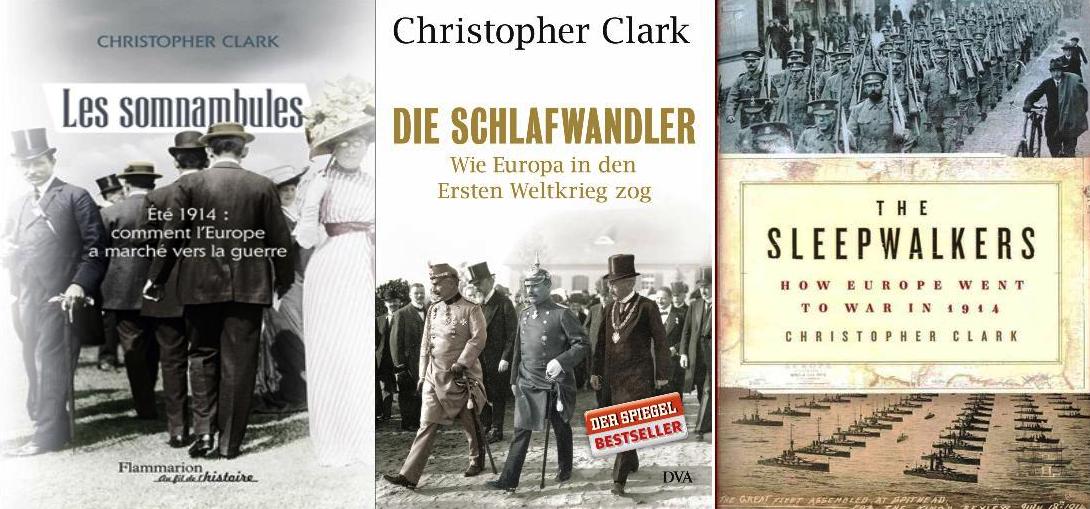
Il semblerait que l’on n’ait pas partout la même vision du somnambulisme
Dans l’exposé des motifs pour l’attribution du prix Aujourd’hui décerné, nous dit-on, sur les deniers personnels de François Pinault, au livre de Christopher Clark, Les somnambules, on pouvait lire ceci, selon France TV info
« Dans Les somnambules. Eté 14: comment l’Europe a marché vers la guerre, l’historien, professeur à Cambridge (Grande-Bretagne), souligne notamment l’écrasante responsabilité des Serbes et du tsar Nicolas II.Il accable aussi l’irresponsabilité des dirigeants français, qui n’ont pas su modérer les Russes, et la légèreté des Britanniques, engagés dans une alliance où ils n’avaient pas leur place. Christopher Clark assure aussi que rien ne laissait prévoir l’effondrement de l’Autriche-Hongrie, qui assurait à ses peuples une prospérité appréciable, même si elle fonctionnait cahin-caha ».
Pour un peu, selon ce brillant résumé, l’Allemagne serait entrée en guerre à l’insu de son plein gré. Ainsi se construisent des renversements dans la lecture de l’histoire.
Mais laissons cela. Christopher Clark dont l’ouvrage est discutable et discuté, du moins en Allemagne, mérite mieux que cela. C’est à la discussion qu’il soulève outre Rhin que sera consacré l’essentiel de cet article.
Un titre qui séduit les hommes politiques
Un mot sur le titre choisi, Les somnambules et sur l’écho dont il bénéficie. L’expression n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Frank-Walter Steinmeier (SPD), à peine nommé aux Affaires étrangères a tenu à souligner l’importance de la commémoration de la «Grande Guerre» avec les propos suivants :
« L’année de commémoration en 2014 sera dominée par la «catastrophe originelle du XXeme siècle». Et j’espère que cette commémoration sera pour nous un avertissement: pour montrer ce qui peut se passer si hommes politiques et diplomates errent sans orientation, comme des «somnambules», et étant loin de se rendre compte qu’ils s’approchent d’un gouffre. Cent ans après la première guerre mondiale notre planète est toujours un lieu dangereux. Ne soyons pas des somnambules mais agissons en patriotes éclairés, en assumant notre responsabilité de l’histoire, dans la tradition d’un Willy Brandt ou d’un Hans-Dietrich Genscher ! »
On n’en saura évidemment pas plus sur ce que serait ne pas être somnambule dans la période actuelle. Qu’importe, l’expression est commode pour faire des discours.
Il est faux de dire qu’ils étaient loin de se rendre compte qu’ils approchaient du gouffre. Ils savaient parfaitement que la guerre était à l’horizon, l’admettaient comme inéluctable mais n’ont rien fait pour l’empêcher. Pourquoi ?
Pourtant on appelle cette guerre la Grande guerre. Les allemands qui jusqu’à présent n’utilisaient pas cette expression s’y mettent aussi. Dois-je en conclure qu’on appelle « grande », une affaire de « somnambules » ? Peut-on appeler cette orgie sanglante une « grande » guerre. Aucune guerre d’ailleurs ne peut s’appeler grande, ce devrait être une épithète interdite. Pas par une loi mais par nos pratiques de langage.
Plus surprenant peut-être est de trouver la référence somnambulique sous la plume d’Alexis Tsipras, du parti grec Syriza, je cite :
« Par contre, je sais qu’une des conclusions principales du livre « Les Somnambules » de Christopher Clark, que la chancelière est en train de lire comme l’a relevé Le Monde est que l’utilisation habituelle de la menace de choix extrêmes comme un objet politique pourrait se comprendre comme une prophétie auto-réalisatrice. »
J’ignorais que dans la gauche grecque et européenne on croyait aux« prophéties auto-réalisatrices »
Bref, le titre choisi est un bon coup marketing, il est aisément instrumentalisable sans doute parce qu’il charrie quelque chose de l’air du temps. C’est ainsi, en effet, que nous apparaissent nos hommes politiques d’aujourd’hui. Le discrédit qui les frappe est tel que nous imaginons volontiers qu’il devait en être de même avant 1914. Est-ce cependant la réalité sous la surface des choses ? C’est un titre qui bloque la réflexion sur les origines de la guerre, sur ce qui en fait la matrice de ce qui est peut-être encore notre présent.
Qu’est ce qu’un somnambule ?
Un somnambule est quelqu’un qui se promène avec beaucoup d’assurance en dormant.Le livre de Christopher Clarck n’est pas le premier à porter ce titre. Dans un essai plus ou moins fictionnel d’Arthur Koestler. « Les Somnambules, ce sont les hommes de la science — Copernic, Kepler, Brahé, Galilée — qui, progressant péniblement parmi les brouillards des thèses erronées, ont ouvert la voie à l’univers newtonien. » peut-on lire dans la présentation par l’éditeur du livre Les Somnambules/ Essai sur l’histoire des conceptions de l’Univers.
C’est aussi et surtout à mes yeux le titre d’un roman de l’écrivain autrichien Hermann Broch qui se déroule entre 1888 et 1918. J’évoque juste le troisième épisode.Huguenau,soldat allemand d’origine alsacienne déserte en Flandres. Il fuit en refusant de retourner en arrière avec pour modèle de réussite Krupp et les barons du charbon, il deviendra courtier, on dit aujourd’hui trader. Il arrive dans les Ardennes.
« A ce moment la guerre avait déjà perdu de sa correction pointilleuse et l’on ne poursuivait plus les déserteurs aussi sévèrement qu’autrefois : il y en avait trop et l’on ne voulait pas s’en apercevoir. Mais cela ne suffit pourtant pas à expliquer que Haguenau ait pu sortir sans encombre de Belgique : il est bien plus probable que ce fut grâce à la sûreté de somnambule> avec laquelle il se mouvait dans cette zone de dangers : il avançait dans l’air clair de l’avant-printemps, il marchait comme sous une cloche pleine d’insouciance, isolé du monde et pourtant dans le monde, et il ne se posait pas de problèmes »
Hermann Broch Les somnambules L’imaginaire Gallimard page 385
Les uns découvrent de la lumière dans le brouillard, les autres ont la « sûreté » face au danger, on verra ce qu’il en est des somnambules de Christopher Clark.
Avant d’entrer dans le cœur de son livre et à sa critique, il faut faire le détour par le travail d’un autre historien allemand auquel tout le monde se réfère et qui constitue également l’une des principales cibles des « Somnambules ».
« Les buts de guerre de l’Empire allemand »
Dans les années 1960, l’historien Fritz Fischer avait secoué l’Allemagne avec son livre « Les buts de guerre de l’Empire allemand » qui faisait porter sur l’Allemagne le poids principal du déclenchement de la guerre.
Fritz Fischer considère qu’on ne peut pas traiter isolément la politique allemande de juillet 1914. : Elle n’apparaît sous son vrai jour, écrit-il, que si on la regarde comme un lien entre la politique d’expansion de l’Allemagne depuis les années 1890 et la politique des buts de guerre depuis août 1914 .
Aussi rappelle-t-il que la question se situe d’emblée dans un cadre impérialiste et de la volonté de faire passer l’Allemagne du statut de grande puissance à celle de puissance mondiale :
« L’Empire allemand de 1871, la création de Bismarck, était une union de l’État prussien, militaire et autoritaire, avec les milieux dirigeants de la bourgeoisie libérale qui s’était développée grâce au commerce et à l’industrie. Cette nouvelle création d’un État relève entièrement de l’histoire du mouvement des États nationaux qui s’étend de 1789 à nos jours et elle y occupe une place particulière et significative dans l’histoire mondiale. Les Allemands furent les seuls à ne pas établir leurs institutions en s’alliant avec la démocratie contre l’ancien régime : au contraire, c’est avec reconnaissance qu’ils reçurent ces institutions des mains de l’ancien régime, comme défense contre la démocratie. Dans le nouvel Empire, l’État prussien, la puissance et la considération dont jouit la couronne de Prusse, la position du président du Conseil prussien en tant que chancelier de l’Empire, le Landtag prussien avec son droit de vote à trois classes pour la Chambre des députés et avec sa Chambre haute essentiellement féodale, la bureaucratie, les écoles, les universités et les églises d’État protestantes, sans oublier les forces armées placées sous le commandement direct des monarques, sont des facteurs garantissant la suprématie des forces conservatrices sur les éléments du libéralisme démocratique et, plus tard, du socialisme démocratique. »
Fritz Fischer Les buts de guerre de l’Allemagne impériale 1914-1918 Traduction Geneviève Migeon et Henri Thies. Editions de Trévise page 19
Comme le livre en français est épuisé, je donne ci dessous encore deux larges extraits. Le premier est le plus controversé. Il date le début des intentions bellicistes de l’Allemagne de fin 1912 :
« …L’empereur avait, le 8 décembre 1912, lors d’une discussion sur la situation « politique et militaire », donné des instructions pour organiser des campagnes de presse ; en cas de « grande guerre européenne » provoquée par le conflit austro-serbe, le peuple allemand devait savoir « à l’avance » pour quels buts il aurait à combattre et par là « se familiariser avec une telle guerre ».
Les fêtes de centenaire qui eurent lieu en 1913 (commémoration de l’appel A mon peuple, inauguration du monument de la bataille des Nations en octobre) peuvent bien être considérées comme la réalisation de ces projets, de même que les parades militaires du 25e anniversaire de l’avènement de Guillaume II, en juin 1913. Les sentiments des milieux nationalistes se reflètent clairement dans le livre du général Friedrich von Bernhardi : Deutschland und der nächste Krieg (L’Allemagne et la prochaine guerre, paru en 1912; sixième édition en 1913). Ce livre est généralement considéré par les historiens allemands comme l’ouvrage d’un pangermaniste forcené dont les opinions dépassent largement les intentions de l’état-major général et du Gouvernement. En réalité, l’auteur y exprime nettement les convictions des représentants officiels allemands en arrivant à la conclusion suivante : «Puissance mondiale ou décadence ». Bernhardi énumère trois facteurs permettant à l’Allemagne’ son accession au rang de puissance mondiale :
I. Elimination de la France: la France « doit être radicalement écrasée, afin qu’elle ne puisse plus jamais entraver notre route ; formule reprise par Bethmann-Hollweg dans son « programme de septembre » quelques semaines après le déclenchement de la guerre.
II. Création d’une confédération d’Etats de la « Mitteleuropa sous l’hégémonie de l’Allemagne. L’espoir de Bernhardi de voir les petits États, « voisins les plus faibles », rechercher la protection des armes allemandes et leur « rattachement à l’Allemagne » sera largement partagé pendant la guerre par les milieux dirigeants. Le développement de la Triplice en une Union de « Mitteleuropa », concentration de forces qui s’oppose au principe de l’équilibre européen, va également devenir un trait fondamental de la politique allemande.
III. Accession de l’Allemagne au rang de puissance mondiale par la conquête de nouvelles colonies. En accord avec les historiens les plus éminents, les économistes, les grands chefs d’industrie et les promoteurs de la « politique mondiale », Bernhardi formule ainsi sa dernière condition: « Il ne s’agit pas aujourd’hui d’un système d’États européens, mais d’un système mondial d’États dont l’équilibre est fondé sur la puissance. Celle-ci ne pourrait être assurée que par de « propres territoires coloniaux et une influence politique prépondérante dans les pays consommateurs ». Puissance mondiale était pour lui synonyme de mission civilisatrice.
Ce même décembre 1912, alors qu’il avait ordonné la préparation psychologique de la population à la guerre, l’Empereur chargea l’Office des Affaires étrangères (c’était son deuxième ordre) d’adopter comme « principe de base de notre politique » la « lutte pour l’existence » des Germains contre les Gaulois et les Slaves et de rechercher partout des alliés … »
Fritz Fischer ibidem page 49
La question des responsabilités.
Dernier extrait enfin, Fritz Fischer aborde la question des responsabilités et signale par anticipation au passage que la thèse des « Somnambules » date de Lloyd George: « Nous avons tous été entraînés dans la guerre. »
« Il est incontestable que, dans ce heurt d’intérêts politiques et militaires, de ressentiments et d’idées qui atteignent leur maximum pendant la crise de juillet, tous les gouvernements des pays européens engagés n’aient eu leur part de responsabilité au déclenchement de la guerre mondiale. Il ne nous appartient pas de discuter en détail la responsabilité de la guerre, ni d’étudier ou de juger la responsabilité des hommes d’État et des militaires des puissances engagées dans le conflit. […] Ici, il importe de démontrer les buts et la politique pratique du gouvernement allemand au cours de la crise de juillet.
Une fois de plus, il faut souligner que sous l’effet des tensions internationales de l’année 1914, provoquées partiellement par la politique d’expansion de l’Allemagne qui avait entraîné déjà trois crises graves en 1905/1906, 1908/1909 et 1911/1912, chaque guerre localisée en Europe à laquelle se trouverait mêlée une grande puissance devait presque inévitablement provoquer une conflagration générale. L’Allemagne, confiante dans sa supériorité militaire, ayant voulu, souhaité et appuyé la guerre austro-serbe, prit sciemment le risque d’un conflit militaire avec la France et la Russie. Le gouvernement allemand portait ainsi la part décisive de la responsabilité historique de la guerre mondiale. La tentative de l’Allemagne d’arrêter en dernière minute cette fatalité ne diminue pas sa part de responsabilité. Ce n’est d’ailleurs que la menace d’une intervention anglaise qui donna lieu aux démarches allemandes à Vienne: ces démarches furent tentées, sans grande conviction, trop tard et aussitôt annulées.
Les politiciens allemands et avec eux la propagande allemande pendant la guerre ainsi que l’historiographie allemande d’après-guerre – surtout après Versailles – soutinrent la thèse selon laquelle l’Allemagne fut contrainte de faire la guerre, ou au moins que la part de responsabilité allemande ne fut pas plus grande que celle des autres dans le sens donné et politiquement motivé par Lloyd George: « Nous avons tous été entraînés dans la guerre. »
Fritz Fischer ibidem pages 99-100
Toute une école historiographique allemande se réclame encore aujourd’hui de Fritz Fischer.
« C’est le mérite de l’historien de Hambourg, Fritz Fischer d’avoir, fin des années 1950, début des années 1960, après un laborieux travail d’archives montré que la responsabilité principale était allemande parce que l’Allemagne en tant qu’allié prépondérant de l’Autriche-Hongrie a donné à cette dernière le feu vert pour frapper la Serbie et ce faisant son allié principal la Russie. » dit l’historien Hans Ulrich Wehler Cette thèse s’est peu à peu imposée en Allemagne et dans le monde. La partie du travail de Fischer qui a été et est encore contestée est l’idée que la guerre avait été planifiée dès 1912.
Mais c’est la thèse centrale de Fischer de la responsabilité allemande qui perdure aujourd’hui parmi les historien allemands que Christopher Clark s’emploie à casser en reprenant une idée pas nouvelle du tout du glissement progressif dans la guerre.
« Chez Clark souffle un vent de déculpabilisation sur la position allemande. Quand on a une fois lu tous les documents accessibles (…), on voit : premièrement que l’état-major voulait une guerre « aussi vite que possible » comme le répétait sans cesse le chef d’état-major, Moltke, parce que la course à l’armement russe et française allait rattraper le niveau de l’armement allemand au plus tard en 1916. Il fallait saisir l’occasion de la supériorité. Deuxièmement, l’état-major avait élaboré ce que l’on appelait le plan Schlieffen. Il fallait selon ce plan tenir le front contre les russes et battre la France grâce à une supériorité sept fois plus grande en l’attaquant par le sud de la Belgique ».
Il est temps d’en arriver à notre lecture des « Somnambules »
Eté 1914 : comment l’Europe a marché vers la guerre, tel est le sous-titre du livre de Christopher Clark, qui tout en étant irritant n’est pas sans intérêt, s’il ne jetait le bébé avec l’eau du bain. Son premier mérite est de nous sortir d’une relation presque exclusivement franco-allemande pour évoquer la Première Guerre mondiale. Si notamment l’examen du partage des responsabilités est légitime, ne plus les hiérarchiser est problématique. Toutes les puissances participantes au déclenchement de la guerre n’étaient pas égales. Le livre s’ouvre sur la Serbie et fournit l’occasion de rappeler que, par exemple, la France possédait les trois quarts de la dette serbe et que cette dette servait à vendre des armes à la Serbie, ce qui n’est pas sans évoquer aujourd’hui l’endettement de la Grèce. Le nationalisme serbe était déconnecté des réalités et s’était construit une « cartographie imaginaire » de la Grande Serbie, persuadé que la désintégration de l’Autriche Hongrie allait en favoriser l’avènement. Le Premier ministre serbe Nikola Pašić avait des scénarios de guerre à l’esprit.
« Ce qui ne signifie pas, écrit Clark, que Pašić ait sciemment cherché à provoquer un conflit généralisé, ou que l’idée de provoquer une attaque autrichienne ait directement influé sur son comportement. Mais peut-être l’intuition que la guerre était une étape historiquement nécessaire de la construction de la nation serbe avait-elle émoussé le sentiment qu’il fallait agir d’urgence pour arrêter le bras des assassins avant qu’il ne soit trop tard. Toutes ces considérations et ces scénarios l’obsédaient certainement tandis qu’il réfléchissait, avec lenteur et pondération, à la façon de traiter la situation créée par la nouvelle du complot de Sarajevo. »
Ainsi Christopher Clark écrit-il parfois l’histoire : peut-être, il se pourrait bien que… Ce qui fait que, pour des journalistes, cela devient c’est la faute aux Serbes ce qu’il n’a jamais dit réellement.
Mais il a des lettres. Son second paragraphe s’intitule L’empire sans qualité, allusion – sans doute, peut-être – au livre de Robert Musil L’homme sans qualité. Cet « empire sans qualité » n’est autre que l’empire austro-hongrois moribond et secoué par des conflits entre les différentes nationalité qui le compose. La double monarchie est dirigée par une « impersonnalité diabolique » (Karl Kraus), l’empereur François Joseph. Les structures de décisions au sein de l’empire sont partagées entre faucons et colombes, avec en tête pour les premiers le chef d’état major des armées, le maréchal Conrad von Hötzendorf qui n’a comme réponse à toute situation que la guerre et à ranger dans les colombe le successeur du trône, l’archiduc Franz Ferdinand, qui rêve d’ États-Unis de la grande Autriche. Il sera assassiné à Sarajevo, le 28 juin 1914 par Gavrilo Princip.
L’Europe d’alors est divisée :
« Si l’on compare la carte des alliances entre grandes puissances européennes en 1887 avec la même carte pour l’année 1907, on voit se dessiner une transformation. La première carte révèle un système multipolaire dans lequel de multiples forces s’équilibrent, bien que de façon précaire. La Grande Bretagne s’oppose à la Russie en Perse et en Asie centrale. La France est déterminée à renverser le verdict de la victoire allemande de 1870. Dans le Balkans, des conflits d’intérêts font naître des tensions entre la Russie et l’Autriche-Hongrie. L’Italie et l’Autriche s’opposent en mer Adriatique Des querelles sporadiques éclatent sur le statut des communautés italophones de l’Empire austro-hongrois tandis qu’entre l’Italie et la France , le climat reste tendu à cause de la politique coloniale française en Afrique du Nord » (page 134)
Un système de traité fait que les tensions ne tournent pas en conflit ouvert. Mais une polarisation du système géopolitique européen s’est mise en place. Elle est pour Christopher Clark « une condition préalable de la guerre qui éclate en 1914 » Une bipolarisation qui a joué autant pour atténuer que pour aggraver les conflits expliquerait cependant l’enchaînement des événements menant de l’attentat de Sarajevo à la guerre. Mais il y a bien une question allemande en Europe depuis Bismarck et la constitution d’un empire allemand. Un problème pour la France « dont la sécurité a toujours reposé sur la fragmentation de l’Europe germanique », pour la Russie, pour la Grande Bretagne, etc… « Cette guerre [de 1870] dira le premier ministre Disraeli, c’est la Révolution allemande, un événement politique encore plus important que la Révolution française du siècle dernier » Un nouvel empire en effet vient troubler le jeu.
Un nouveau venu dans la famille des impérialismes
« Il existe une différence évidente mais fondamentale entre l’empire allemand, nouveau venu sur la scène internationale et ses rivaux. Comme la Grande-Bretagne, la France et la Russie possèdent de vastes portions de la surface habitée de la planète et contrôlent militairement des régions périphériques de leurs empires respectifs, elles disposent de territoires ou d’ avantages à marchander ou à échanger à moindre frais pour la métropole. Par exemple, la Grande-Bretagne a la possibilité de faire des concessions à la France dans la région du Mékong ; la Russie, celle d’offrir à la Grande-Bretagne de délimiter des zones d’influence en Perse ; la France celle de proposer à l’Italie l’accès à des territoires convoités en Afrique du Nord. L’Allemagne, en revanche, ne peut entrer dans ce jeu de négociations, parce qu’elle est continuellement dans la position du parvenu qui n’a rien à offrir et lutte pour se faire une place au soleil. Quand elle tente de s’emparer d’une part des maigres portions encore disponibles, elle se heurte à la résistance du club des habitués » (page 152-153).
 En d’autres termes la seule puissance ayant intérêt à faire bouger le statu quo, c’est l’Allemagne. Et personne ne se demande de quelle manière ces contradictions inter-impérialistes auraient pu être résolues par la paix . La question n’est même pas effleurée. Christopher Clark rappelle le discours retentissant prononcé en 1897 par le Secrétaire d’état aux affaires étrangères, von Bülow : « Le temps où les Allemands laissaient la terre à l’un de leur voisin, la mer à l’autre, et ne gardaient pour eux-mêmes que les cieux où règne la philosophie pure, ce temps est révolu. Nous ne souhaitons faire d’ombre à personne, mais nous aussi nous exigeons d’avoir notre place au soleil »
En d’autres termes la seule puissance ayant intérêt à faire bouger le statu quo, c’est l’Allemagne. Et personne ne se demande de quelle manière ces contradictions inter-impérialistes auraient pu être résolues par la paix . La question n’est même pas effleurée. Christopher Clark rappelle le discours retentissant prononcé en 1897 par le Secrétaire d’état aux affaires étrangères, von Bülow : « Le temps où les Allemands laissaient la terre à l’un de leur voisin, la mer à l’autre, et ne gardaient pour eux-mêmes que les cieux où règne la philosophie pure, ce temps est révolu. Nous ne souhaitons faire d’ombre à personne, mais nous aussi nous exigeons d’avoir notre place au soleil »
L’Allemagne veut participer au banquet colonial. D’autant plus qu’elle connaît un miracle économique et manque de débouchés. Sommes-nous si loin qu’on le dit des thèses de Fritz Fischer ? La guerre par ces enjeux n’est-elle pas d’entrée mondiale alors que des historiens nous affirment qu’elle ne l’est devenue qu’au cours de son déroulement ?
Certes, ce ne sont pas des -ismes (colonialisme, impérialisme) qui déclenchent des guerres mais des hommes. Ils n’empêchent qu’ils sont pris dans des -ismes dont ils ne révèlent pas la nature parce qu’ils n’en ont pas l’intelligence. A l’exception de la France, qui est une république, les autres sont des monarchies dirigés par de piètres politiques qui n’ont de compte à rendre à personne. Le pouvoir, ils n’ont pas eu à le conquérir, ils l’ont hérité. Ils n’ont pas besoin de storytelling, de cadre narratif cohérent. Ils confondent les parades militaires avec les champs de batailles. En plus, ils sont cousins, souvent capricieux. Mais l’on se demande tout de même si Christopher Clark n’attache pas trop d’importance à leur versatilité. Il s’en régale oubliant peut-être que c’est précisément avec des dirigeants indécis que les lobbies guerriers et financiers qui savent ce qu’ils veulent l’obtienne. L’examen du système politique à lui seul ne permet pas de comprendre les lignes de forces qui conduisent à la tragédie.
Encore une citation caractéristique de la démarche de Clark, affirmer une chose et la noyer dans des circonvolutions interrogatives :
« Le culte de la chose militaire envahit la vie publique et la vie privée, jusque dans les plus petites communautés. Comment ce militarisme influence-t-il les décisions qui mènent l’Europe à la guerre en 1914 sont-elles comme l’on affirmé certains historiens, dans l’abdication des autorités civiles et l’usurpation du pouvoir politique par les généraux ? »
On aimerait connaître votre réponse Monsieur Clark !
Pourquoi dites-vous que l’affirmation du Colonel House écrivant au Président Woodrow Wilson qu’ en Europe « le militarisme y vire à la folie » est une exagération ?
Gerd Krumeich raconte que De Gaulle pas encore général mais officier prisonnier des Allemands avait, lors d’une conférence donné dans le camp des officiers, affirmé que les Allemands perdront la guerre parce que les militaires avaient désappris à obéir. Une « idéologie sacrificielle » se met en place qui parvient à faire en sorte que la guerre soit considérée comme « un mode parmi d’autres des relations humaines ». La guerre était considérée comme un moyen de la politique. Clark rappelle que les rédacteurs en chef des journaux sont embarqués dans la militarisation. Il met l’accent sur le « chaos décisionnel ». Mais le « chaos décisionnel » lui même a une origine. Difficile d’affirmer que personne ne voulait la guerre quand la guerre est considérée comme acceptable sinon souhaitable pour résoudre les conflits et forger les caractères. La vraie difficulté est dans l’ampleur qu’elle a prise.
La poudrière des Balkans
Les somnambules focalisent sur la poudrière des Balkans. Par les systèmes d’alliances, ils se retrouvent au centre de la géopolitique européenne.
Un des meilleurs passages du livre parle de la Lybie, montrant d’une part que c’est finalement par des guerres coloniales que tout a commencé, et qu’on y a, d’autre part, expérimenté de nouvelles techniques sur des soldats arabes. Il en cite deux : les bombardements aériens qui ont été expérimentés par l’Italie en février 1912 et les projecteurs électriques. Il cite un observateur britannique, Ernest Bennett : « le spectacle de ces malheureux soldats arabes pris dans la lumière électrique me remplit de tristesse : projecteurs, mitrailleuses Maxim, batteries, navires de guerre, aéroplanes – ils avaient si peu de chance de s’en sortir »
La série de conflits qui dévastent les Balkans commence en Afrique du Nord. L’attaque de l’Italie donne le signal d’une offensive des Balkans contre l’empire ottoman. Je n’entre pas dans le détail du chaos balkanique où s’opère en outre « le renversement des anciens schémas d’allégeance ». Les politiques étrangères se mènent à coup de crédits qui servent à l’achat d’armement et à la construction de chemins de fer, vecteurs de mobilité stratégique.
Tout a l’air calme pendant que s’accentue la course aux armements et que la bataille fait rage pour la conquête de nouveaux marchés.
« Dans la course pour le contrôle des concessions pétrolières si convoitées de Mésopotamie, les banques, les investisseurs britanniques soutenus par Londres, n’ont aucun mal à mettre les Allemands en difficulté en usant à la fois de marchandage agressif et de diplomatie financière impitoyable. Même dans le domaine des chemins de fer, qui représente la moitié des investissements allemands dans l’Empire ottoman (…), les Français font pratiquement jeu égal (…). Ces derniers contrôlent 62,9 % de la dette publique ottomane (administrée par une agence internationale au profit des créanciers de l’Empire), L’Allemagne et la Grande Bretagne se répartissent le reste à part quasiment égale. Enfin l’institution financière la plus puissante de Constantinople, la Banque impériale ottomane – qui contrôle le lucratif monopole du tabac, ainsi que de multiples entreprises, sans compter le droit exclusif d’imprimer les billets de banque ottomans – est une institution franco-britannique et non allemande. Elle constitue également un instrument politique aux mains des Français dans la mesure où Paris gère ses opérations de crédit et sa fiscalité »
Heureusement qu’il n’y a pas, à ce qu’on nous dit, de conflits inter-impérialistes !
Les « frontières » entre impérialismes se situent parfois loin de l’Europe. Entre la Grande Bretagne et la Russie, elles passent par l’Asie centrale, la Perse. Ces éléments constituent des données géopolitiques – les tracés de lignes de chemin de fer sont interprétées, par exemple, comme preuves d’une stratégie offensive.
Tous les états-majors, y compris français, se mettent en posture offensive et « la logique de guerre préventive exerce une pression occulte mais forte sur les raisonnements des principaux décideurs pendant la crise de l’été 1914 »
Comment s’opère le passage ?
Crise de la masculinité ?
Christopher Clark s’ essaye à cette interprétation.
Je crois que l’on peut passer sur ce chapitre.
Toujours est-il qu’il ne nie pas l’existence de causalités qu’il multiplie à plaisir et c’est ce qui fait l’intérêt de son livre. Il persiste néanmoins à affirmer que « l’avenir était ouvert ». Là, j’ai du mal à suivre. Pour la bonne et simple raison qu’au niveau des décideurs, la paix n’était pas envisagée comme alternative au règlement des conflits. Ils en étaient loin, considérant la guerre comme un moyen légitime.
Le dimanche 28 juin 1914, l’héritier du trône austro-hongrois est assassiné à Sarajevo déclenchant une onde de choc qui allait conduire à la guerre. Christopher Clark s’y attarde longuement ainsi que sur l’implication de la « main noire » et les complicités serbes. C’est une partie fortement contestée notamment pas l’historien britannique Max Hastings, le plus sévère :
« Les sources serbes sur lesquelles s’appuie Clark ne sont pas du tout fiables. Sa démonstration de la complicité entre le gouvernement serbe et la Main noire [Organisation secrète nationaliste serbe], qui se base sur une remarque du ministre serbe de l’intérieur en 1920, est irrecevable. De plus, je ne vois pas comment le premier ministre Nikola Pasic et “Apis”, chef des services secrets serbes et de la Main noire, aurait pu faire cause commune alors qu’ils se détestaient. Bien sûr, la Serbie était un facteur de déstabilisation régionale. Mais aucune preuve ne nous permet d’affirmer qu’elle est responsable de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand ».
Je me contente de le noter, il m’est difficile d’avoir un avis sur la question. Il me semble que la responsabilité directe de la Serbie n’est pas établie, pas suffisamment du moins. Il n’en va pas tout à fait de même pour la suite du récit qui dédouane beaucoup trop facilement l’Autriche-Hongrie et son principal allié l’Allemagne. Gerd Krumreich a établi dans son dernier livre ce qui fait consensus en Allemagne et qui fera l’objet de la troisième partie .
Restons encore un instant avec « l’histoire maîtresse d’école excentrique peuplée de somnambules » chère à Christopher Clark. Il atténue la portée de l’ultimatum autrichien à la Serbie en le présentant comme plus modéré que l’ultimatum de l’OTAN à la Serbie en 1999. Il est pourtant admis qu’il ne laissait aucune porte de sortie diplomatique à la réponse serbe. L’idée générale est tout de même qu’il faut régler une fois pour toute la question serbe. C’est le point de vue de Guillaume II mais aussi de la France d’après Clark qui cite l’ambassadeur belge à Paris : « L’état-major français est favorable à la guerre » (page 476). Le 28 juillet 1914, l’empereur François-Joseph signe la déclaration de guerre à la Serbie.
Dès lors les dés sont jetés.
Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France.
Chez Christopher Clark, chacun en prend pour son grade. C’est l’aspect positif. Il ne peut cependant pas s’empêcher d’être caricatural quand il écrit :
« Le déclenchement de la guerre de 1914 n’est pas un roman d’Agatha Christie à la fin duquel nous découvrons le coupable debout près d’un cadavre dans le jardin d’hiver, un pistolet encore fumant à la main. Il n’y a pas d’arme du crime dans cette histoire, ou plutôt il y en a une pour chaque personnage principal. Vu sous cet angle, le déclenchement de la guerre n’a pas été un crime, mais une tragédie. Reconnaître cela ne signifie pas que nous devons minimiser le bellicisme et la paranoïa impérialiste des décideurs politiques allemands et autrichiens qui ont attiré à juste titre l’attention de Fischer et des ses alliés historiographiques. Néanmoins les Allemands n’étaient pas les seuls a avoir été impérialistes ni à avoir succombé à la paranoïa ; la crise qui a entraîné la guerre de 1914 était le fruit d’une culture politique commune. Mais elle était également multipolaire et authentiquement interactive, ce qui en fait précisément l’événement le plus complexe des temps modernes, et c’est la raison pour laquelle les débats sur son origine se poursuivent, un siècle après que Gravilo Princip, posté au coin de la rue François Joseph , a tiré ses deux coups de pistolets fatals. »
J’ai envie de mettre ce passage en collision avec la dernière phrase du livre :
« Où que nous jetions notre regard dans cette Europe de l’avant guerre, nous rencontrons cette légèreté désinvolte. En ce sens, les protagonistes de 1914 étaient des somnambules qui regardaient sans voir, hantés par leurs songes mais aveugles à la réalité des horreurs qu’ils étaient sur le point de faire naître dans le monde ».
Des somnambules bellicistes, impérialistes et paranoïaques ? Difficile de faire passer le général von Moltke pour un somnambule, de même que le chef d’Etat major autrichien, von Hötzendorf. Quant au lieu de la tragédie, on a un peu de mal à le situer là où pour l’essentiel C. Clark la situe. Dans les ambassades. Surtout en l’absence de dimension sociale totalement occultée.
La théorie de la localisation
Le livre de Christopher Clark participe d’un travail encore peu fréquent – c’est bien plus vrai encore de l’historiographie française – de description détaillée de l’avant guerre. De ce qui s’est passé juste avant que ça ne casse.
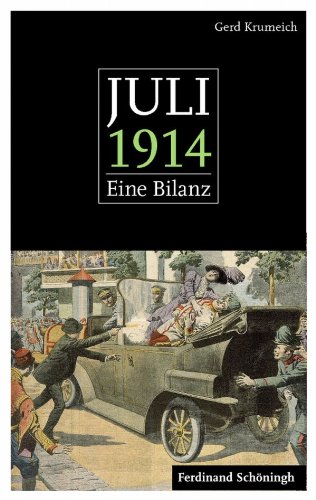
Dans son livre Juli 1914, eine Bilanz (Juillet 1914, un bilan, non traduit), bilan de ce que l’on sait, Gerd Krumeich trace la piste de la « théorie de la localisation ». C’est pour lui précisément cet objectif de la politique allemande de tester la réaction russe en cas d’attaque de la Serbie par l’Autriche-Hongrie qui allait déraper. L’histoire de cet avant-guerre est là aussi examinée du point de vue du système de puissance et des équilibres de pouvoir. Krumeich rappelle lui-aussi la vieille histoire des Balkans où « n’ont cessé de s’affronter la Russie comme protectrice des petits peuples slaves et l’Autriche-Hongrie, Etat multi-ethnique composé de partie importantes de ces mêmes peuples » . La crainte d’isolement de l’Allemagne a renforcé le poids de son alliance avec l’Autriche.
C’est bien la question de l’impérialisme, n’en déplaise à Nicolas Offenstadt, qui est au cœur de la période. Devenir puissance mondiale ou décliner était l’alternative considérée comme vitale. Elle était partagée par les universitaires y compris Max Weber qui considérait que ce n’était pas la peine d’avoir fait tant d’efforts pour construire l’unité nationale si elle ne devait par servir de point de départ d’une politique de puissance mondiale. Cette conception était partagée par tous les pays.
Je quitte un moment le livre de Krumeich pour m’arrêter un instant sur la question de l’impérialisme puisque Nicolas Offenstadt en critiquant Lénine jette le bébé avec l’eau de bain. Facile de dire que l’impérialisme n’était pas « le stade suprême du capitalisme », merci, nous nous en étions rendu compte, mais cela n’enlève rien à la question de l’impérialisme elle même. Quelle est son origine ?
« Essoufflement des secteurs industriels de la première génération ; renforcement et organisation des classes ouvrières dans les pays capitalistes développés ; durcissement de la concurrence intercapitaliste ; crises violentes … – certains voient là le symptômes de l’effondrement prochain du capitalisme.
Mais déjà de nouveaux et importants secteurs industriels se déploient; de nouveaux modes de domination sur les travailleurs et de nouvelles relations avec la classe ouvrière se préparent; et, au-delà des réactions défensives (protectionnisme cartels), à leur abri, s’amorce une fondamentale mutation du capitalisme: concentration et centralisation du capital industriel, formation de trusts et de monopoles nationaux, et, indissociablement, mondialisation de l’aire d’influence des capitalismes dominants, à travers le commerce et l’exportation de capitaux, la formation de groupes multinationaux, la colonisation qui conduit au partage du monde ».
Michel Beaud : Histoire du capitalisme 1500-2010 Points économie page 210-221 l’âge de l’impérialisme
Le chapitre se conclut ainsi :
« Rivalités, concurrence, frictions, affrontements ; intérêts industriels et financiers, mais aussi élans patriotiques ; même si elle n’en est pas la seule cause, l’expansion impérialiste des capitalismes nationaux à la fin du XIXème et au début du XXème siècle est fondamentalement à l’origine de la « Grande Guerre » de 1914-1918. »
Dire enfin comme Offenstadt que « les interdépendances étaient en fait très fortes entre les économies et que, pour nombre de secteurs (assurances, sociétés minières…), la paix était préférable à la guerre », revient à dire que, comme les principales têtes couronnées d’Europe étaient cousins, elles ne sauraient se faire la guerre.
Retour à G.Krumreich.
« C’est sans aucun doute la politique de puissance mondiale et maritime agressive de l’Allemagne qui a transformé de manière décisive le concert européen des puissances, en ce début du XXème siècle ».
Faisant appel à l’historien Wolfgang Mommsen, il ajoute que la politique mondiale de l’Allemagne, à la différence de la France et de l’Angleterre, n’était pas portée par une tradition et une classe impérialistes. De son côté, Poincaré, président de la République française a pratiqué avec les Russes une politique de prise en tenailles de l’Allemagne.
« Depuis la crise d’Agadir en 1911 [entre la France et l’Allemagne à propos du Maroc], la guerre était dans l’air et personne n’aurait été surpris si elle avait éclaté fin 1911. »
Par ailleurs, si la guerre a éclaté en 1914 plutôt qu’en 1916, c’est bien parce que l’Allemagne considérait sa puissance comme supérieure à ce moment là et qu’attendre allait réduire son avantage. La folle course aux armements avait conduit à un surarmement tel qu’il a mené à considérer que « le plus tôt serait le mieux ». Les plans de guerre, affirme avec force Gerd Krumeich, misaient sur la courte durée. Il en veut pour preuve l’épuisement rapide des munitions. On peut évidemment se demander comment les états majors pouvaient imaginer cela sachant qu’ils mettaient des millions d’hommes en mouvement. Par ailleurs, on devine bien que si elle avait été annoncée comme longue, l’enthousiasme pour la guerre aurait sans été considérablement émoussé. Il y a quelque ambiguïté dans ce résumé :
« D’une certaine manière, on savait qu’une guerre européenne pouvait devenir une catastrophe mais on croyait quand même qu’on pourrait précisément éviter la catastrophe par des décision claires et rapides »
L’attentat de Sarajevo non plus n’était pas totalement une surprise même s’il s’est déroulé comme « dans une scène d’un film de Chaplin avec certes une fin mortelle et des conséquences mondiales ». Le principal reproche que Krumeich fait à Christopher Clark, son livre en fourmille mais je ne retiendrai que celui-ci, c’est de s’attarder longuement sur cette histoire jusqu’à en perdre le fil et la signification politique. N’est-ce pas d’ailleurs son but ? Du point de vue de l’historien allemand, l’historien australien n’apporte pas réellement la preuve de la complicité du gouvernement serbe dans l’attentat même s’il admet des complicités dans l’armée et les douaniers. Pour le premier « le gouvernement de la double monarchie s’est montré dès le début déterminé à utiliser les circonstances pour en finir avec le problème serbe ». Cela ne minimise en rien la part allemande dans l’escalade du conflit. Pourquoi l’Allemagne a-t-elle signé un chèque en blanc à son allié ? Il explique cela en faisant appel à un jeu de pur hasard qu’on appelle en allemand « vabanque ». L’expression est née du jeu français du pharaon, un jeu de quitte ou double qui, comme son nom le suggère, profite surtout au banquier du jeu, à ce qui « va à la banque » d’où l’expression « vabanque ». La théorie de la localisation est ainsi un jeu de hasard.
J’ai traduit deux pages du livre de Gerd Krumeich, les pages 183 et 184 qui expliquent clairement me semble-il son propos :
« Qui donc porte la responsabilité du déclenchement de la 1ère guerre mondiale ou n’y a-t-il aucun coupable et toutes les puissances ont-elles glissé plus ou moins consciemment dans la guerre pour reprendre la formulation de réconciliation des années 1920 ? Ou les hommes politiques étaient-ils réellement des somnambules ou mieux ont-ils dans leur rêve dansé sur un volcan en ignorant qu’ils allaient le pousser à l’éruption ? Mes conclusions à l’examen des dossiers des acteurs, de leurs agissement, de leurs omissions, est sans ambiguïté : l’Empire allemand et l’Autriche Hongrie se sont livrés à un jeu de risque tout (Vabanquespiel) qui ne craignait pas la grande guerre pour faire pencher en leur faveur la balance de la politique européenne. L’attentat de Sarajevo a été utilisé de manière déterminée pour libérer l’Autriche-Hongrie de la pression serbe et pour essayer de savoir si la Russie était décidée et prête à la guerre et jusqu’où elle était prête à y aller. L’unanimité régnait parmi les dirigeants des empires allemand et autrichien pour considérer que le danger russe, depuis longtemps jugé menaçant, nécessitait une telle mise à l’épreuve pour asseoir la position de l’Allemagne et de la monarchie danubienne dans le concert des puissances. Typique pour l’époque étaient les obsessions provenant du darwinisme selon lesquelles l’Empire russe en pleine croissance deviendra avec ses potentialités économiques et militaires à plus ou moins long terme un facteur incalculable. La crainte d’une possible agression de la Russie avec son allié la France s’est transmuée dans l’opinion partagée par la direction wilhelmienne qu’il valait mieux la guerre « maintenant que plus tard » puisque de toute façon guerre il y aura. Ce fatalisme de la pensée dominait chez les « puissances d’Europe centrale » et avec le « saut dans l’inconnu » – expression utilisée par le chancelier Bethmann Hollweg pendant la crise de juillet – on pensait encore pouvoir trouver un rivage salvateur.
Ce ne sont pas les ambitions de puissance mondiale ou la recherche d’une suprématie impériale qui ont été les éléments moteurs pour les décisions de juillet 1914 mais une peur prononcée de l’avenir. Cette peur s’est accentuée depuis le début du siècle et est devenue une sorte de profond sentiment partagé par les Allemands. C’était la peur d’être littéralement entouré, oui « encerclé » par des puissances envieuses comme l’avait dit le Chancelier Bülow en 1906. De fait, les autres puissances ont fait mouvement les unes vers les autres -rapprochements informels- pour contenir l’Empire allemand qui menaçait par le développement de sa démographie et de ses forces productives de leur faire de l’ombre. Il y avait aussi bien en Angleterre qu’en France et en Russie des craintes massives devant un voisin aussi imprévisible que dynamique au centre du continent. Les Allemands par leurs fougueuses ambitions et leurs comportements souvent maladroits sur le parquet diplomatique se sont « exclus d’eux-mêmes » mais le comportement des Russes, des Français et des Anglais faisaient en sorte de transformer les craintes d’encerclement en véritable phobie. Peser le pour et le contre de tout cela dans le détail s’avère une tâche totalement impossible. Toutes les grandes puissances avaient le format impérial, toutes avaient à l’ère de l’impérialisme le souci du développement futur avec des composantes de peur et des sentiments de déclin diversement répartis. Si donc les puissances d’Europe centrale dans ma conviction portent la responsabilité principale d’avoir mis le feu aux poudres, elles ne sont pas les seules à avoir accumulé tant de munitions «
Gerd Krumeich Juli 1914, eine Bilanz Verlag Ferdinand Schöningh Pages 183-184. Traduction B. Umbrecht
Avant de quitter le livre , une dernière citation qui y est contenue : un extrait du célèbre discours d’August Bebel prononcé au Reichstag en novembre 1911, trois ans avant le début de la guerre :
Ainsi de tous côtés on s’armera encore et encore […] jusqu’au moment où l’une ou l’autre partie dira plutôt une fin dans la terreur qu’une terreur sans fin […] Ce sera alors la catastrophe. Alors ce sera en Europe la grande mobilisation générale qui verra 16 à 18 millions d’hommes, dans la fleur de l’âge, de différentes nations, jetés les uns contre les autres sur les champs de bataille, armés des meilleurs instruments meurtriers.[…]. Le crépuscule des Dieux du monde bourgeois est annoncé[…].
La citation du fondateur de la social démocratie allemande appelle deux remarques. Bebel avait beau être social-démocrate et donc suspect intellectuellement pour la droite et les historiens qui ne prennent pas de tels points de vue en considération – encore moins Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg – il est tout de même un peu difficile après un tel discours – de 1911- de parler de somnambules. Tout le monde savait qu’une telle hypothèse était plausible. Le problème est que cela n’a pas empêcher le SPD de voter les crédits militaires. La seconde question est de savoir pourquoi la dernière phrase s’est avérée fausse, en d’autres termes, pourquoi la guerre a sauvé le monde bourgeois plutôt que d’en hâter la fin.
Pour compléter son interprétation, Krumeich doit faire appel à des notion telle que l’hybris, le fétichisme de la technique en expliquant que personne n’avait idée du potentiel d’énergie qui allait être mis en branle.
Quelles qu’aient été les conceptions sur la durée supposée courte de la guerre, ces considérations ne modifient en rien l’énormité des pertes en vies humaines qui avait été prise en compte par les états majors et les politiques qui les suivaient. La guerre est en effet d’abord la permission de tuer son prochain avec la bénédiction des églises, son horizon est la mort. En 1913, a été fêté en grande pompe le centenaire de la bataille de Leipzig entre les troupes de Napoléon et la « Sainte alliance » des troupes russes, autrichiennes et prussiennes avaient fait en trois jours 170.000 morts sur un effectif de 500.000 hommes engagés. Un simple calcul … Le spectacle des boucheries avait par ailleurs déjà présidé à la naissance de la Croix Rouge. L’horreur était programmée. La vie humaine avait peu de prix. Durs Grünbein, à la fin de son discours de remerciements pour le prix Büchner déclarait :
« Pendant la 1ère guerre mondiale, alors que des millions de Woyzecks crevaient dans les tranchées, un déserteur à Mülheim inscrivit sur le mur sa nouvelle addition : Qu’est ce qu’un mort ? 170 livres de viande froide, 4 seaux d’eau, un paquet de sel »
La guerre de 14-18 comme laboratoire
Herfried Münckler dans son livre « der Grosse Krieg »(La Grande guerre, non traduit, Rowohlt 2013) définit la guerre de 14-18 comme le « laboratoire » dans lequel a été développé presque tout ce qui dans les conflits futurs jouera un rôle :
« de la guerre aérienne stratégique, qui ne distingue pas entre combattants et non combattants jusqu’à l’expulsion et l’extermination de groupes entiers de population ; de l’idée d’une croisade pour des idéaux démocratiques qui servit à justifier l’intervention du gouvernement des USA dans la guerre européenne à une politique d’infection révolutionnaire dans laquelle les parties en guerre se servent de courants ethnoséparatistes ou religieux pour semer le désordre dans le camp adverse. La première guerre mondiale a été la couveuse dans laquelle se sont développées toutes ces technologies qui font partie de l’arsenal des acteurs politiques. Ne serait-ce que pour cette raison, une étude attentive de cette guerre vaut le coup ».
J’en suis bien d’accord, alors reprenons succinctement quelques points en détail.
Notons d’abord que la puissance qui profitera de ce suicide de l’Europe, ce seront les Etats-Unis véritables vainqueurs de cette guerre.
En 1935, Faulkner écrit dans le compte-rendu d’un livre sur la Première Guerre mondiale, Test pilot, quelque chose qui annonce la guerre des automates, des drones :
« Ce serait le folklore non pas du siècle de la vitesse ni des hommes qui en sont les acteurs, mais de la vitesse en soi, dont les protagonistes ne seraient ni des humains ni des êtres mortels, mais des machines ultra perfectionnées, douées de volonté, ne transportant aucun être vivant, destiné à mourir et susceptible de souffrir, se déplaçant vers un but invisible sans dessein compréhensible, suscitant une littérature privée d’amour et de haine et, ça va sans dire, de pitié et de terreur, une littérature où serait contée la disparition totale de la vie à la surface du globe. Je les regarderais, ces mortels chétifs et frêles, disparaître dans un espace de vide infini, intemporel, empli du rugissement de machines incroyables, un espace traversé de météores en furie se déplaçant dans le vide, se ruant nulle part sans s’arrêter ni ralentir, à jamais voués à se détruire les uns les autres » (Essais, discours et lettres ouvertes, pp. 241-42, traduction modifiée).
Cité par Michel Gresset : William Faulkner : « …ce monde voué à la destruction » in Ecrire la guerre . Editions du Magazine littéraire (2013) pages 59-61
« Une révolte de la technique »
La question de la technique est aussi présente dans l’analyse de la guerre par Walter Benjamin :
« Sans diminuer en rien l’importance des causes économiques de la guerre, on est en droit d’affirmer que la guerre impérialiste, dans ce qu’elle a précisément de plus dur et de plus néfaste, est partiellement déterminée par la disparité criante entre les moyens gigantesques de la technique et l’infime travail d’élucidation morale dont ils font l’objet. En effet, de par sa nature économique, la société bourgeoise doit retrancher aussi rigoureusement que possible la technique de la sphère dite spirituelle, elle doit empêcher aussi résolument que possible la pensée technique de participer à l’organisation sociale. Toute guerre à venir sera aussi une révolte de la technique contre la condition servile dans laquelle elle est tenue »
W.Benjamin Théories sur le fascisme allemand Œuvres II Folio Essais page 199
La période qui précède la guerre est celle où le monde change aussi sur le plan énergétique :
« Un monde mécanique, tirant ses forces motrices des énergies froides (l’eau, le vent, etc.. s’efface. Un autre le remplace, animé par les énergies chaudes du feu »
(René Passet Les grandes représentations du monde et de l’économie LES LIENS QUI LIBERENT EDITIONS )
A propos de la manière de fomenter des troubles chez l’adversaire, évoquée par Herfried Münckler, on peut rappeler ici l’épisode de la traversée de l’Allemagne en wagon plombé de Lénine négociée avec les autorités allemandes intéressées de pouvoir soulager leur front Est.
La question intéressante est aussi de savoir dans quelle mesure 14-18 perdure dans la société civile si tant est que l’on puisse considérer que la distinction civils/militaires recouvre une distinction front/arrière. Tout le monde était à des degrés divers dans la guerre. Quelqu’un comme Antonin Artaud n’en est jamais sorti jusqu’à la fin de sa vie. Pouvons-nous dire que nous sommes encore dedans ?
L’étude de la guerre de 14 fournit aujourd’hui encore des leçons de management. Il faudrait, nous dit-on, « étudier les leçons de commandement de la Grande Guerre dans toutes les formations qui préparent à des fonctions d’autorité ». Avec l’idée de fusiller pour l’exemple quelques salariés pour faciliter le travail de management et hâter la venue de capitalisme de barbarie et d’esclavagisme que l’on nous annonce ?
Je reprends un passage de l’introduction du livre de Herfried Münckler sur le rôle des intellectuels , universitaires, ceux qui font partie de ce qu’il appelle la Deutungselite, littéralement l’élite qui fournit les interprétations:
« La 1ère guerre mondiale fut la première guerre dans laquelle les intellectuels ont joué politique influent […] : l’élite intellectuelle et universitaire n’a cessé de se mêler aux affaires de l’élite décisionnelle, ce faisant, ils ont plus contribué à l’escalade qu’à la modération. ». Il cite comme exception Max Weber : « d’origine plutôt ardent nationaliste et partisan d’une politique impériale de l’Allemagne, il a très tôt compris la situation précaire des puissances d’Europe centrale, poussé à une paix basée sur l’entente, rejeté des annexions, et s’est prononcé contre la guerre illimitée sous-marine ».
La question du nombre, de la masse
« La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire à elle. Les hommes meurent effectivement, et non plus un à un , mais en nombre, souvent par dizaines de milliers en un seul jour. Et il ne s’agit plus de hasard. Il apparaît certes encore que c’est par hasard que cette balle atteint l’un et pas l’autre, une seconde balle peut aisément l’atteindre ; l’accumulation met fin à l’impression de hasard ».
Sigmund Freud Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort
Si j’y arrive, je reviendrai sur ce texte et sa lecture par Marc Crépon, je me contente de relever ici que quelque chose change dans la mort avec la question du nombre, de la masse.
Avec la production de masse s’annonce la consommation de masse. Le 24 avril 1913, dans une mise en scène soignée, le président Woodrow Wilson allumait à distance, par télégraphe, les 80.000 ampoules décorant le gratte-ciel Woodworth à New York, il inaugurait avec cette « cathédrale du commerce » l’ère de la consommation de masse.
Production de masse, consommation de masse, guerre de masse, mort de masse.
Lorsque, dans une incidente, Gerd Krumeich, dans un entretien avec Alexander Kluge déclarait que le « rapport quantité /qualité » n’avait pas été pris en compte par les historiens, je me suis souvenu avoir lu quelque chose chez Gilles Chatelet dans Vivre et penser comme des porcs sur la question du nombre en relation avec la guerre de 14-18 par référence à Jules Romain.
« Quant aux chefs militaires, ils apprenaient, en se tâtant avec inquiétude, en se mordant la lèvre pour être sûr qu’ils ne dormaient pas, l’insondable nouveauté d’un événement qu’ils avaient préparé à loisir, mais sans aucunement le concevoir : une guerre faite par des millions d’hommes.
Ils découvraient les propriété physiques, antérieures et comme indifférentes à toute stratégie, du « million d’hommes » : sa fluidité, son aptitude à réparer sur place les trous qu’on lui a faits ; à envelopper, engluer, amortir la pointe qui le pénètre ; à ployer sous le coup, à s’incurver sans se rompre ; à s’allonger par coulure à travers tout un territoire pour y tendre une frontière provisoire et vivante, le « million d’hommes » se trouvant juste appartenir au même ordre de grandeur que les dimensions des Etats ; … »
Jules Romain Les hommes de bonne volonté. Prélude à Verdun, Laffont page 6.
Et voici le commentaire de Gilles Chatelet pour qui le nombre apporte une qualité nouvelle qui est autre chose qu’une juxtaposition d’individus, aux antipodes de l’ « individualisme de masse »:
« Que faire de ce levain prometteur, de ce protoplasme dont chaque frémissement peut déployer une dimension nouvelle, de cette innocente gravité du « million d’hommes » ? Nous connaissons trop bien la suite ; la marche forcée vers les « lendemains qui chantent », vers la « Race » et l’ »Espace vital » a, à sa manière, donné un « poids politiques » et un impact à cette amibe géante en lui fabricant un destin de chair à canon ou à haut fourneau.
Le New Deal inventa – c’est son mérite – une solution plus raisonnable. Une astucieuse chimie sociale permit de préserver les qualités naturelles de cette masse : homogénéité, élasticité, tout en canalisant ses potentiels vers les demandes d’un Grand Marché. On éliminait ainsi toutes ces dimensions dangereuses « antérieures et comme indifférentes à toute stratégie » dont l’articulation risquait de transformer les dizaines de millions d’hommes en bombe vivante. On disposait de tous les avantages d’une chair à ratifier, décidément plus sage – et quelque fois bien plus mobilisable – que la chair à canon et ses prestations mécaniques. On avait réussi à écarteler la belle unité mobile de Jules Romain , à exorciser tout ce qui fait que les cinq cent mille sont toujours bien plus que la juxtaposition de cinq cent mille individus »
Gilles Chatelet Vivre et penser comme des porcs Exil 1998 pages 53-54.
Je sors des lectures d’historiens avec un lancinent sentiment d’insuffisance. J’ai déjà évoqué, au passage, ce qui me paraît être sans doute l’une des raisons : la question de la paix. Je reviens à l’un des textes déjà cités de Walter Benjamin dans lequel il apostrophe les frères Jünger et leurs amis en ces termes :
« Nous n’admettrons pas que vienne nous parler de la guerre celui qui ne connaît rien d’autre que la guerre. Radicaux à notre manière, nous demanderons : D’où venez-vous Et que savez-vous de la paix ? »
La guerre n’est pas morte en 1918, ni en 1945. Alors que nous sommes de nouveau dans un monde au bord de l’explosion, avec des instruments juridiques internationaux en piètre état, bafoués par les puissances qui devraient en être les garantes, c’est la question de la paix qui nous intéresse à savoir comment peuvent se régler sans guerre généralisée les problèmes qui se sont accumulés. La paix non pas comprise simplement et de manière insuffisante comme la non-guerre car on entend à nouveau poindre le sentiment de profond ennui devant une paix du statu quo.
J’ai conscience du caractère lacunaire de ce qui précède. On ne peut pas tout lire ne serait-ce qu’en raison du prix des livres. Soit dit en passant,une fabuleux marché. L’idée de cette publication et de celles qui suivront est celle d’une tentative d’approche citoyenne d’un centenaire. Je fais partie de ceux qui pensent que nous n’en avons pas fini avec le 20ème siècle et se sentent concernés par ce centenaire pour les raison évoquées ci-dessous :
Le centenaire comment ?
« Ce centenaire-là ne saurait être une fête.
Car ce qui commence en 14, d’abord, et qui ne s’est certes pas achevé depuis, n’est pas simplement une bataille ou une série de batailles : c’est l’épreuve d’une violence de masse, et d’une violence extrême. L’histoire a mis bien longtemps à le reconnaître, à y voir un fait central, et il serait paradoxal et à vrai dire scandaleux qu’on l’oublie de nouveau aujourd’hui, à l’heure du centenaire le plus officiel.
Le bilan de « 14 » ne tient pas seulement à la mortalité de masse produite par l’immense conflit. L’« acquis de violence » a trait aussi à l’extension du phénomène concentrationnaire, apparu dès la charnière du XIXème et du XXème siècle, mais qui trouve au cours des année de guerre une systématisation nouvelle ; il tient au ciblage des populations désarmées, qui désormais incarnent aussi l’ennemi : le génocide des Arméniens perpétré en 1915 constitue la pointe extrême de cette logique nouvelle de l’élimination. À quoi s’ajoute l’après-coup : les deux grands totalitarismes du XXème siècle ne l’ont pas emporté – l’un en 1917, l’autre en 1933 – en raison seulement de l’ampleur des ruines laissées par le conflit : atroces héritiers des grandes attentes véhiculées par la guerre, ils ont réinvesti dans le champ politique les pratiques de violence qu’elle avait générées »
Extrait de Fréderic Worms, Christophe Prochasson, Stéphane Audouin- Rouzeau, Marc Crépon : 1914 : questions pour une commémoration Revue Esprit Mai 2013
Ce contenu a été publié dans
Histoire, avec comme mot(s)-clé(s)
"1914 : questions sur une commémorationn,
"Juli 1914",
"Les somnambules",
"Révolte de la technique",
August Bebel,
Christopher Clark,
ère guerre mondiale,
Fritz Fischer,
Gerd Krumeich,
Gilles Chatelet,
Hans Ulrich Wehler,
Herfried Münckler,
Hermann Broch,
Impérialisme,
Jules Romain,
LA question du nombre,
Les Balkans,
Les buts de guerre de l'Allemagne impériale,
Masse,
Max Hastings,
Militarisme,
Nicolas Offenstadt,
Serbie,
Sigmund Freud,
Théorie de la localisation,
Walter Benjamin. Vous pouvez le mettre en favoris avec
ce permalien.

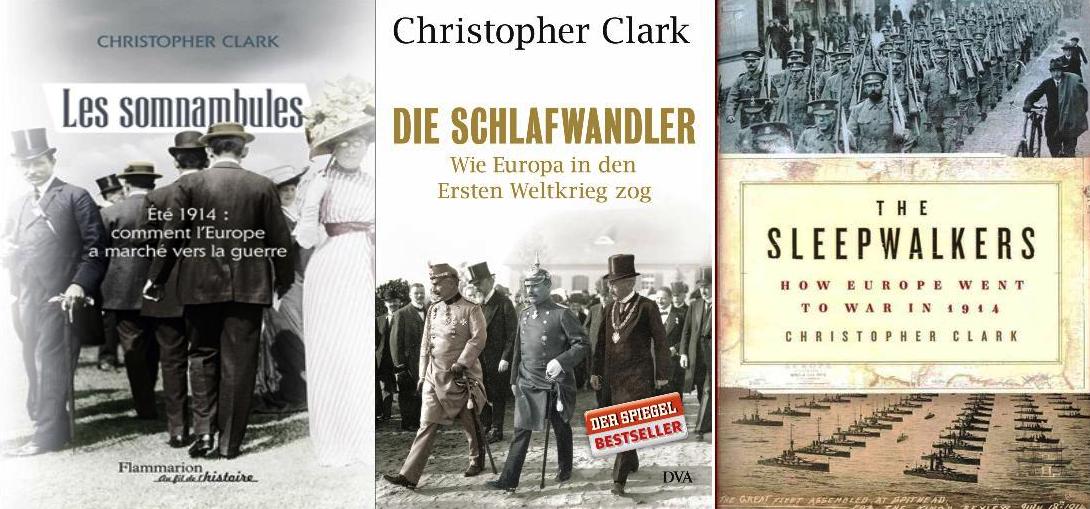

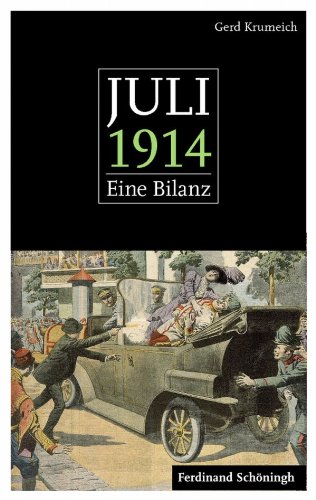

 Follow
Follow


