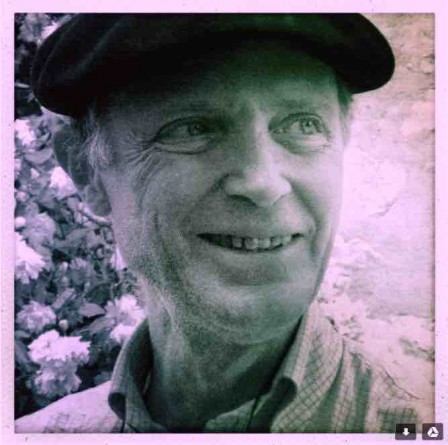
Raymond Josué Seckel. (Source de la photographie : L’Alamblog)
Pour moi, qui ignorait jusqu’à peu qu’il avait un second prénom, il était Raymond Seckel, fils du pasteur Seckel. Ce dernier officiait, la dernière fois que je l’ai rencontré pour les obsèques de ma mère, au Temple Saint Jean de Mulhouse. Avec Raymond Josué Seckel, nous avions été, pour les années terminales, camarades de lycée, à l’époque le Lycée de garçons Albert Schweitzer de Mulhouse, la mixité devra attendre le passage de Mai 68. Comme pour quelques autres avec lesquels j’ai gardé des relations jusqu’à aujourd’hui, j’ai dû me retarder d’une année pour les rencontrer. Mais je ne l’ai pas fait exprès. Raymond, je l’ai très très peu connu. Après le lycée, je l’ai croisé l’une ou l’autre fois à Strasbourg où il avait appris le métier de libraire, puis une fois à la nouvelle Bibliothèque nationale où il exerçait la fonction de Directeur du département de la Recherche bibliographique. J’avais vu également, en 2007 ou en 2008, la remarquable – et très remarquée – exposition dont il avait été co-commissaire avec Marie-Françoise Quignard : Éros au secret, l’Enfer de la Bibliothèque. Il avait travaillé à la réédition du catalogue parue en 2019. On le surnommait parfois Pluton, du nom du Dieu qui domine l’Enfer. Je n’ai appris que très récemment par l’une de ses amies qui m’annonçait son décès, le 14 novembre 2019, qu’il avait pris connaissance de l’existence du SauteRhin par un reportage photographique que j’avais réalisé sur la découverte d’une « cité ouvrière » du 16ème siècle au lieu-dit La Fouchelle, à Sainte-Marie-aux-mines, sa ville natale. Un livre hommage à l’homme au béret vient de paraître : Raymond Josué Seckel, le bibliothécaire des deux rives. Les deux rives sont celles de la Seine et rappellent la traversée du fleuve par le transfert, entre 1994 et 1998, de la Bibliothèque nationale de Richelieu à Tolbiac en devenant la BnF. Raymond Seckel avait aussi un côté saute-Rhin dont le livre témoigne. A commencer par le texte que je publie ci-dessous d’un autre camarade de lycée. Avant cela encore un petit détour par Robert Musil.
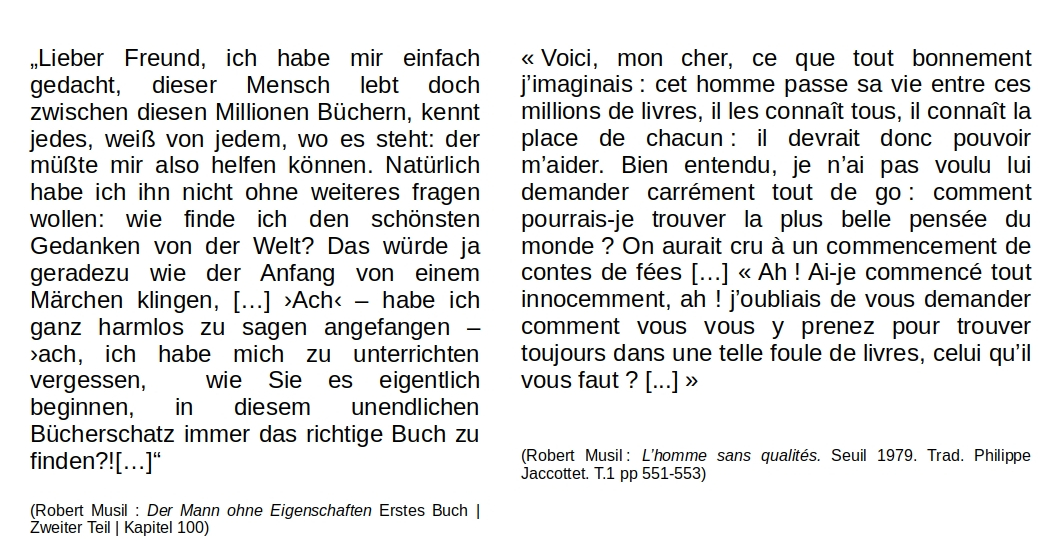
L’extrait en français figure dans le livre-hommage dont il est question ici. Cependant, si la description du personnage par Robert Musil « colle » à celui que Claire Paulhan nomme « le maître des fiches et des fichiers », il est à relever une différence sensible. Le personnage imaginé par Musil ne lit que des catalogues et jamais les livres qu’il indexe, ce qui n’était clairement pas le cas pour Raymond Josué Seckel. A preuve, ses chroniques littéraires parues entre 1983 et 1986 dans le Matin de Paris dont une sélection figure dans le livre. En atteste aussi son attachement au chef d’œuvre de la littérature allemande, écrit en exil à Strasbourg, qu’est le Lenz de Georg Büchner et à son célèbre incipit daté d’un 20 janvier : Den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg. Quelques courriels destinés aux amis et intitulés Le petit bleu, sont repris dans l’ouvrage. Dans l’un d’entre eux, il écrivait en note pour signaler sa sortie d’hôpital le 21 janvier 2019 : « je tiens plus au 20 janvier (profitez de ce début d’année pour lire/relire Lenz de Georg Büchner) ». Selon Marie-Noelle Bourguet-Seckel, son épouse, il aimait offrir, autour de lui, ce diagnostic mental poétique, puissant dans son inachèvement même, qu’il considérait comme un « livre terrible mais aussi livre de vie ». J’en ai parlé ici. Pierre Frantz l’évoque ci-après, à partir de conversations qu’il avait eues avec Raymond-Josué Seckel. Ce faisant, il nous rappelle aussi une époque où, loin des nostalgies pseudo-identitaires, se revivifiait, en Alsace, un dialogue culturel critique entre l’Allemagne et la France. Époque révolue mais peut-être pas perdue et susceptible d’être réactivée pour peu que nos institutions culturelles régionales cessent d’agir comme si elles vivaient hors sol.

Extrait de »Waldersbach » par Sylvain Maestraggi. Postface Jean-Christophe Bailly. Ed. L’Astrée rugueuse
Lenz par Pierre Frantz
Dans l’une de nos toutes dernières conversations, Josué a évoqué un spectacle, Lenz, Jour et nuit sur la cathédrale de Strasbourg, que j’avais vu à Strasbourg en mai ou juin 1980. Il s’agissait d’une adaptation d’un texte célèbre, que Josué admirait beaucoup, où Büchner raconte le séjour de Lenz, dans une crise de folie, à Waldersbach, chez le pasteur Oberlin. Un texte qui relève, ou du moins se rapproche, du genre de la nouvelle. Un récit où le tout jeune Büchner, fasciné, se confronte à cet autre torturé par la folie au milieu d’une nature sublime et violente, mais entouré par un milieu protestant bienveillant. Josué avait eu plaisir à rappeler ce texte avec le sérieux, la réserve et la discrétion qui lui était coutumière. Lenz, c’était un spectacle qui avait lieu sur la plateforme de la cathédrale, 142 mètres au-dessus du parvis. J’avais été saisi, bouleversé par l’étrangeté radicale de ce moment de théâtre qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. C’est ce souvenir que j’aimerais évoquer. Il n’a pas la fraîcheur de l’enfance : nous étions des jeunes hommes. Mais il a la force des découvertes de la pensée et il rappelle les temps d’entrée dans la vie intellectuelle. Il est exemplaire de ce qu’est la mémoire du théâtre, un art dont les critiques, les acteurs et les metteurs en scène répètent à l’envi qu’il est éphémère et qui ne l’est pas plus qu’un autre car plus que tous les autres il a besoin de la mémoire pour sa vie éphémère et se montre aussi durable et aléatoire que la mémoire elle-même. Depuis cette conversation, elle-même fruit du hasard d’une rencontre improbable, sur le campus d’une université américaine, les souvenirs de ce spectacle et de cette soirée de jeunesse s’appellent et se mettent à la suite les uns des autres. De ce Lenz, je n’ai réussi à trouver que peu de traces. Un article de Colette Godard, si perplexe qu’elle hésite à exprimer son sentiment, et, sur youtube, un film, long entretien avec le metteur en scène, Johannes Klett, peu avant sa mort, réalisé par Heinz Cadera, Alexander Bugel et Sébastien Lange. Et puis deux amis, Jean-François Lapalus et Alain Rimoux qui tous deux jouaient dans la pièce. Les mots de Johannes Klett ont fait ressurgir de l’oubli des architectures disparues, des émotions enfouies. Il y a peu de place sur la plateforme. Il y avait donc peu de spectateurs, pour cet événement qui est demeuré plutôt confidentiel. J’avais écrit le lendemain un article de critique : je ne sais plus pour quelle revue et, comme c’était une époque où on écrivait sur une feuille de papier, avec son stylo, je n’en ai plus trouvé aucune trace. Scripta volant, verba manent. Voilà qui aurait fait sourire notre savant bibliographe, lui qui savait retrouver les textes disparus et les livres oubliés, qui, si souvent, me dénichait une brochure poussiéreuse ou un joli manuscrit, dormant sur un rayon de la rue de Richelieu.
C’était la grande époque où Jean-Pierre Vincent dirigeait le Théâtre national de Strasbourg. Un temps de créations formidables. Autour du TNS et de Vincent, qu’inspirait une véritable vision, André Engel, Bernard Chartreux, André Wilms, Évelyne Didi, Bernard Freyd, Michel Deutsch, Sylvie Muller participaient à un projet puissant, qui confrontait les cultures de la France et de l’Allemagne, leurs histoires tragiques, leurs traditions d’ordre, aussi terribles que leurs désordres, dans des rencontres parfois étonnantes. C’était aussi une époque fortement marquée à Strasbourg par deux philosophes concernés directement par le théâtre, Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe. Pour nous, qui étions, aussi bien Josué que moi ou la moitié de ceux qui faisaient alors le TNS, des Alsaciens entièrement français, qui vivions à Paris, et qui n’accordions – n’accordons – qu’une importance très relative aux « identités », cette époque fut celle d’une maturation et d’une intense stimulation intellectuelle. La génération qui nous précédait avait effacé et refoulé la culture alsacienne, pour des raisons qu’il est aisé de comprendre. La nôtre la retrouvait, la découvrait, non pas dans le régionalisme ou le folklore mais dans sa portée universelle. Pas non plus comme une culture nationale allemande, certes réprimée et ignorée, mais bien comme alsacienne. Le TNS rétablissait alors le dialogue séculaire et nous permettait d’entrer dans la confrontation, féconde et souvent tragique, entre l’espace culturel français et l’espace germanique. Dans une critique aiguë des stéréotypes qui marquent nos deux histoires. Le TNS était, en ce début des années 1980, l’âme de ce dialogue franco-allemand, souvent rugueux, dont témoignent aussi la série de spectacles sans concession, terriblement discutée, Vichy fictions ou les projections de Hitler un film d’Allemagne de Syberberg. Le théâtre retrouvait à Strasbourg, au tournant des années 1970-1980, dépassant les utopies éducatives qui marquent l’idéologie du théâtre populaire, la puissance d’un art qui anime une société : elle s’y manifestait, non pas dans la stupidité d’une communion mais dans l’agitation vivace de l’intelligence. Josué suivait à sa façon – il ne pouvait manquer d’y penser – la route de Lucien Herr. Il était l’homme des livres (nul d’entre nous ne lisait autant que lui), non l’homme du livre comme son père pasteur, et sa curiosité le poussait au-delà, vers le théâtre, car si la bibliothèque ouvre sur le monde et les autres, le livre peut isoler le lecteur dans la seule compagnie des mots et des sciences. Lenz était une rencontre. Johannes Klett raconte qu’avec les comédiens et ceux qui participaient à son projet, ils traversèrent à pied les Vosges enneigées, en janvier 1980, jusqu’à Waldersbach où le pasteur Oberlin avait recueilli Lenz. Plus récemment et avec une intuition semblable, Simon Delétang, le directeur du Théâtre de Bussang, est lui aussi parti à pied dans les Vosges pour rencontrer, à hauteur d’homme, les habitants des Vosges autour de ce même texte de Büchner. Le spectacle était né de cette rencontre qui, dans son ensemble, faisait événement unique.
À Strasbourg, au TNS, l’influence de Brecht était immense mais tout ce qu’elle pouvait avoir parfois de didactique et d’étroitement idéologique, chez les brechtiens français tout particulièrement, se trouvait submergé par une puissante poésie théâtrale. Jean-Pierre Vincent s’était tourné vers les pièces du jeune Brecht et ses mises en scène de La Noce chez les petits-bourgeois ou Dans la jungle des villes, qui sans doute étaient marquées par un regard politique, se détournaient de la vulgate scolaire et glacée, issue des Lehrstücke, pour ouvrir sur Hölderlin ou Sophocle. Un esprit comparable animait André Engel qui, faisant sortir le théâtre des murs, avait fait représenter Baal dans les haras de Strasbourg ; Week-end à Yaïk d’Essenine, emmenant les spectateurs dans une visite touristique d’un Strasbourg-Moscou soviétique ; ce fut ensuite un spectacle Kafka, intitulé Hôtel moderne, faisant suivre des scènes de cabaret par d’autres qui mettaient chaque spectateur, individuellement, dans une chambre d’hôtel, en présence d’un comédien qui disait le texte de La Colonie pénitentiaire, dans une performance dont le pouvoir d’inquiéter tenait à ce seul fait que l’on était en contact direct et personnel avec un autre séparé, un personnage. Lenz sur la terrasse de la cathédrale relevait d’une démarche analogue, transformant totalement le théâtre par détournement de son lieu propre. Le lieu cathédrale était principiel, essentiel, et de cette terrasse, c’est l’Alsace, l’Allemagne et la France qu’on voyait.
En trois langues, le français, l’allemand et l’alsacien, un texte se disait, tissu constitué de plusieurs bandes juxtaposées. Le récit de Büchner était diffusé continûment, à mi-voix, en allemand et il semblait sourdre des pierres. De même une litanie de noms de personnes persécutées en Alsace par les nazis. En français les descriptions de la nature. Des scénettes de Robert Walser faisaient surgir les personnages et des bouts de dialogue, Goethe, Frédérique Brion, Lenz. Goethe et Lenz étaient incarnés par plusieurs comédiens, dans des costumes de la fin du XVIIIe siècle, de ton rougeâtre, comme les pierres de la cathédrale à laquelle ils paraissaient unis. Chacun exprimait un aspect du personnage. Lenz c’était l’histoire d’un homme brisé, d’un grand écrivain sans cesse confronté à un génie vrai et incontesté, Goethe, qui ne lui témoignait guère d’attention. Condamné à aimer celle dont le génie ne voulait plus. Chacun des comédiens, jouant Lenz ou jouant Goethe, exprimait ce contraste à sa façon. Johannes Klett rappelle, dans le film, le gestus qui caractérisait, par exemple Lenz, contraint, courbé, prisonnier de soi-même, empêché1, face à un Goethe2 serein, solaire et glorieux, ou à Frédérique Brion3. Peut-être aussi ce contraste était-il celui de l’Alsace – suggéré par la présence de sa langue dans le spectacle – empêchée, contrainte de ressembler à l’autre, en face des deux puissants pays voisins, qui s’affrontent en elle, et tour à tour avec elle. Le seul ordre narratif était celui que donnait le passage du jour à la nuit car le texte était en quelque sorte disséminé.
La cathédrale était à soi seule un spectacle incroyable. On accédait à la plateforme par un escalier étroit en colimaçon et on arrivait hors d’haleine devant la tour, alors que le soleil rougeoyait à l’ouest. La lumière révélait les fines arcatures, se jouait de la pierre, des embrasures et des percées. La cathédrale était bien ce lieu symbolique majeur de la ville et de l’Alsace mais elle évoquait aussi la montagne, que Lenz avait gravie.
À l’ouest et à l’est, les dômes montagneux attiraient le regard. Un alpiniste, du reste, escaladait la tour, décuplant l’impression de vertige qu’on pouvait ressentir. Tout était aspiré vers le sentiment du sublime, de la montée du spectateur à celle des acteurs, du soleil couchant à la nuit qui donnait au texte sa fin. On redescendait par un autre escalier à l’intérieur de la cathédrale, qu’illuminait un projecteur, à travers la rosace.
Le texte de Büchner était projeté vers le ciel, vers l’immensité de la vue sur la ville, la plaine, l’horizon des Vosges et de la Forêt-Noire. On rejoignait Lenz dans ce qui n’était plus une crise, mais un monde, intérieur et extérieur tout à la fois. Lenz triplement incarné, rêvant et rêvé, comme le rêveur de Borges, par Büchner, par les personnages, par les comédiens, enfin par chaque spectateur, envahi par la montagne à laquelle la cathédrale communiquait l’élan vertical, le vertige. Car dans la nouvelle de Büchner, l’évocation de la nature extraordinairement présente raconte, selon une sorte de métaphore prolongée et réitérée, la crise de folie de Lenz mais aussi le sentiment de Büchner, au delà de la compassion, un partage.
« Le 20, Lenz passa par la montagne. Neige en altitude, sur les flancs et les sommets ; et dans la descente des vallées, pierraille grise, étendues vertes, rochers, sapins. L’air était trempé, froid ; l’eau ruisselait le long des rochers et sautait en travers du chemin. Les branches des sapins pendaient lourdement dans l’atmosphère humide. Des nuages passaient dans le ciel, mais tout était d’une densité… puis le brouillard montait, vapeur humide et lourde qui s’insinuait dans l’épaisseur des fourrés, si molle, si flasque4. »
La nature donne voix aux êtres qui la parlent et sont parlés par elle. Rien de plus littéraire. Et pourtant rien de plus théâtral : elle s’engouffrait, aspirée par l’assomption sublime du lieu. Peut-être était-ce cela qui avait intéressé Josué à ce spectacle, car il était un homme du lieu, lui qui avait aimé aussi profondément la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu, qui était désolé de la quitter mais avait fini, je crois, par s’en libérer dans les responsabilités et les aventures nouvelles qui s’étaient offertes à lui avec la création de la bibliothèque François-Mitterrand. L’évocation de ce spectacle a pour moi aussi valeur d’un rappel : les conversations et les échanges qui naissent des livres et du théâtre ne s’interrompent pas et, pour peu qu’on y soit attentif, se poursuivent bien au-delà de la mort.
1. Jean-François Lapalus, André Wilms, Alain Rimoux.
2. Alain Rimoux, Jean-François Lapalus, Bernard Freyd.
3. Évelyne Didi versus Dominique Muller
4. Je cite la traduction de Jean-Pierre Lefebvre, Éditions du Seuil, 1988 [2007], coll. « Points ».
Pierre Frantz : Lenz. Texte tiré du livre hommage Raymond Josué Seckel, le bibliothécaire des deux rives. Éditions des Cendres. 2021. Je remercie Pierre Frantz ainsi que Marie-Noëlle Bourguet-Seckel, Nadine Férey-Pfalzgraf, Jean Didier Wagneur et les Editions des Cendres pour leur aimable autorisation me permettant de publier ce texte.
Pierre Frantz est professeur émérite de littérature française à Sorbonne Université. Il a fait ses études à Mulhouse, puis à la Sorbonne. Il a enseigné à l‘Université de France-Comté puis à Paris X-Nanterre. Il est spécialiste de l‘esthétique et du théâtre du XVIIIème siècle.
« Josué suivait à sa façon – il ne pouvait manquer d’y penser – la route de Lucien Herr. », écrit Pierre Frantz. Lucien Herr (1864-1926), natif d’Altkirch en Alsace, fut le Bibliothécaire de l’École normale de la rue d’Ulm de 1888 à 1926. Il a été un cofondateur en 1904 du quotidien L’Humanité, dont il a trouvé le titre et dont il fut l’un des rédacteurs en politique étrangère. On trouvera plus de détails dans l’article de l’encyclopédie Wikipedia qui lui est consacré.
Je me suis concentré sur la dimension en quelque sorte SauteRhin de ce livre. J’aurais pu également évoquer l’intérêt de Raymond pour le Capitaine Dreyfus, un autre mulhousien, ou son attachement à Berlin et à ses Currywurst. Il y a cependant bien d’autres aspects dans ses 384 pages consacrées à cet « émigré alsacien à Paris » selon l’expression de son fils. Qualifié de « magicien » par Jacques Roubaud, la figure du bibliothécaire qu’il fut, se trouve en traces dans une fiction : Le rêve de Saxe de Michel Chaillou. Un magicien en enfer, aurait pu être un titre pour cet ensemble.
Jules Valles au British Museum
Beaucoup de contributions des uns et des autres concernent des relations plus ou moins de travail avec celui qui paraissait incarner et donner « un visage, un sourire, à une abstraction un peu effrayante qu’est une bibliothèque réputée porter toute la mémoire du monde »(Tierry Grillet). Je voudrais pour terminer signaler le contrepoint bienvenu que constitue l’article de Michèle Sacquin-Moulin sur un écrivain que j’aime bien. Sa contribution s’intitule : « la bibliothèque idéale de L’insurgé / Jules Vallès au British Museum ». Exilé à Londres pour échapper à la répression des Communards, Vallès qui avait assidûment fréquenté la Bibliothèque impériale puis nationale à Paris était en mesure de la comparer à celle du British Museum où il avait quasiment installé son bureau. Dans Une rue à Londres, il y consacre un chapitre. « Si Londres est une caricature de Paris, le British Museum, par un curieux renversement, devient, ou peu s’en faut la bibliothèque idéale », écrit Michèle Sacquin-Moulin.
Je ne résiste pas au plaisir d’un petit extrait :
« Les garçons de notre bibliothèque Richelieu ont un uniforme, une tunique à boutons de métal, un gilet rouge, un chapeau à cornes ; il y a je crois des caporaux et un sergent. Partout, la griffe de Napoléon Ier a laissé des traces, et il faut qu’on sente la caserne même dans le Musée des Lettres. Les Anglais se sont bien gardés de ce ridicule, et ont laissé aux horse guards les chiffons couleur de sang. En revanche, il y a des roses piquées aux boutonnières des employés ; ils se fleurissent comme s’ils étaient de noce , et parfois le volume qu’ils vous apportent sent la fleur de saison. En France, on trouverait cet amateur de bouquets indigne de sa fonction sévère ; il lui en resterait une odeur mauvaise sur son dossier, ses chefs lui en voudraient d’avoir paru un insouciant, au lieu d’être un immatriculé et d’avoir, sans ordre, acheté et arboré trois œillets ou une touffe de réséda »
(Jules Vallès : Une rue à Londres)
Pour Vallès, « une bibliothèque devrait être jour et nuit à la disposition des lecteurs » (et non les lecteurs à disposition des bibliothèques) et les employés de celle de Londres, même s’ils croyaient en Dieu et à la Reine étaient pour lui de « l’Internationale du travail ». Salut, camarade !
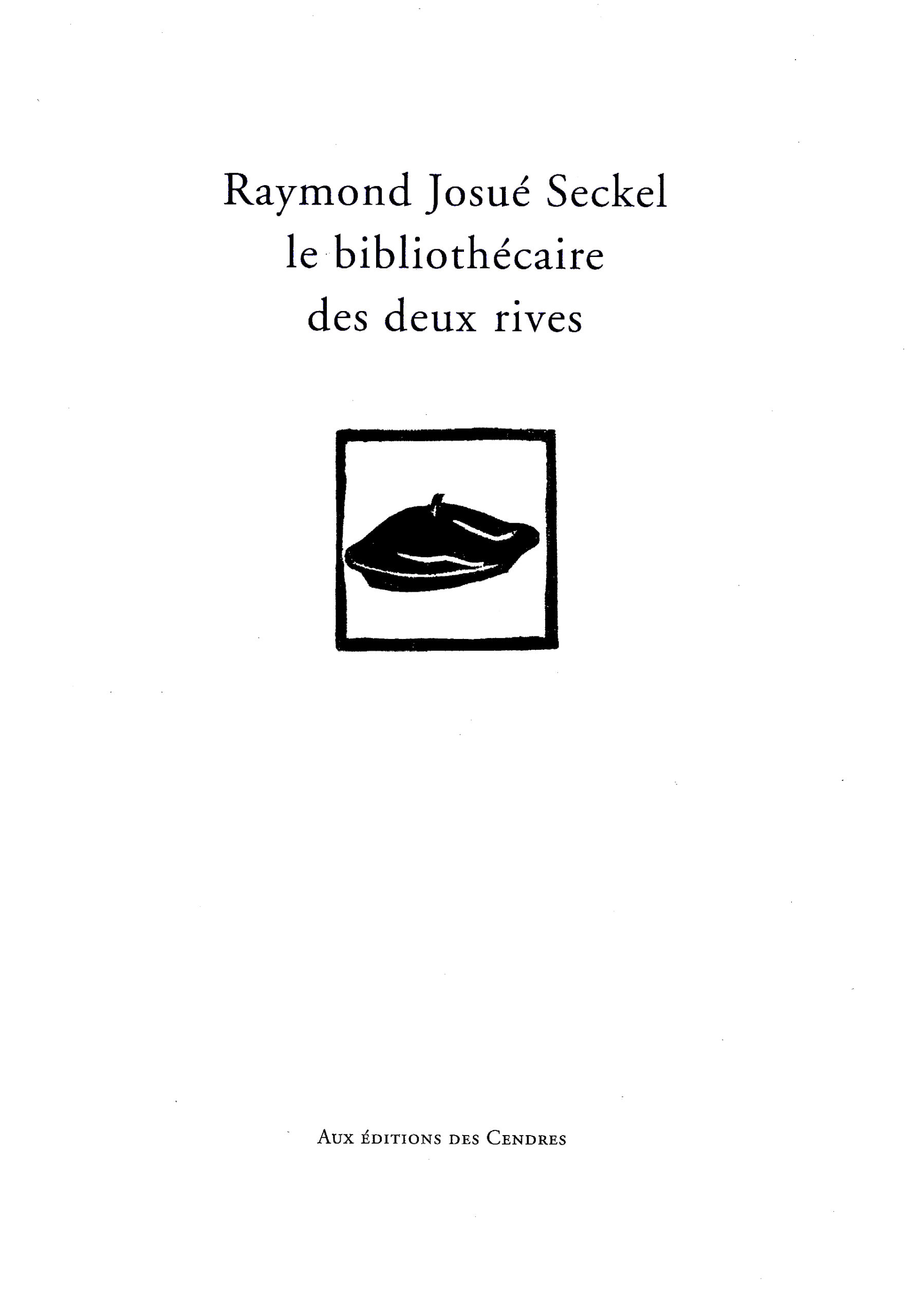
Couverture de la belle édition du livre hommage paru en 2021 avec une linogravure de Maxime Préaud : Béret


 Follow
Follow
Bonjour,
étant alors élève de Claire Nancy à Fustel de Coulanges, nous étions allés assister à cette représentation, presque en voisins. En ce jour du décès d’André Wilms, j’ai le souvenir vif de cette représentation telle qu’elle est décrite dans le texte de Pierre Franz, que j’ai eu grand plaisir à lire également pour son évocation du TNS dans ces années 1975-1985, où chaque pièce laisse encore une trace indélébile à quarante ans de distance.
Salutations, TB