Au début de son célèbre ouvrage L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Max Weber explique que contrairement à ce que pensent « de modernes romantiques pleins d’illusions » ce n’est pas l’auri sacra fames [« L’abominable faim de l’or » (Virgile)] qui fait la différence entre le pré-capitalisme et le capitalisme dont il essaye d’étudier la naissance mais ce qu’il appelle la création d’un « esprit du capitalisme », c’est-à-dire une transformation mentale, culturelle, spirituelle dans laquelle la Réforme protestante, plus calviniste que luthérienne d’ailleurs, a pris une part déterminante. Il montre que le capitalisme qui avait besoin de la mise en place d’une nouvelle rationalité sociale ne peut se servir d’homme d’affaires sans scrupule. Il a besoin d’une bourgeoisie. Cette dernière en ce sens n’existe plus.
Face à la crise du capitalisme d’aujourd’hui, celui du capitalisme consumériste qui a succédé au capitalisme industriel, c’est bien la question d’une transformation des esprits qui est à l’ordre du jour.
« Le manque absolu de scrupules, l’égoïsme intéressé, la cupidité et l’âpreté au gain ont été précisément les traits marquants des pays dont le développement capitaliste bourgeois – mesuré à l’échelle occidentale – était resté en retard. (…). Le capitalisme ne peut pas utiliser le travail de ceux qui pratiquent la doctrine du liberum arbitrium indiscipliné, pas plus qu’il ne peut employer – Franklin [i.e. Benjamin Franklin] nous l’a montré – un homme d’affaires absolument sans scrupules. La différence n’est donc pas une question de degré dans la soif du gain pécuniaire. L’auri sacra fames est aussi vieille que l’histoire de l’homme. Mais nous verrons que ceux qui s’y soumettent sans retenue – tel le capitaine hollandais qui « irait en Enfer pour gagner de l’argent, dût-il y roussir ses voiles » – ne pourraient à aucun titre passer pour des témoins de l’« esprit » spécifiquement moderne du capitalisme considéré comme phénomène de masse; et cela seul importe. À toutes les époques de l’histoire, cette fièvre d’acquisition sans merci, sans rapport avec aucune norme morale, s’est donné libre cours chaque fois qu’elle l’a pu. Semblable en cela à la guerre et à la piraterie, le commerce libre s’est souvent révélé dépourvu de frein moral dans ses rapports avec les étrangers ou avec ceux qui n’appartenaient pas au même groupe. Cette « morale pour l’extérieur » [Aussenmoral] permettait en ce cas ce qui était interdit avec des frères. En tant qu’« aventure », l’acquisition capitaliste a été un phénomène familier dans toutes les économies monétaires, pour ceux qui faisaient fructifier l’argent, que ce soit par les commenda, la ferme des impôts, les avances de l’État, le financement des guerres, les cours princières ou les fonctionnaires. L’état d’esprit de l’aventurier qui se rit de toute limitation éthique a donc été universel. La brutalité consciente et absolue de l’acquisition s’est souvent trouvée dans un rapport extrêmement étroit avec le conformisme le plus strict et le respect de la tradition. Toutefois, avec l’effritement de celle-ci et l’insertion plus ou moins complète de la libre entreprise dans la société, cette nouveauté n’a été ni justifiée moralement ni encouragée, mais seulement tolérée comme un fait. Fait tenu pour éthiquement indifférent, voire répréhensible, mais malheureusement inévitable. Ce fut là non seulement l’attitude normale de tout enseignement éthique, mais aussi – chose importante – le comportement pratique de l’homme moyen à l’époque « précapitaliste », en ce sens que l’utilisation rationnelle du capital dans une entreprise permanente et l’organisation rationnelle capitaliste du travail n’étaient pas encore devenues la force dominante qui détermine l’activité économique. Cette attitude fut justement l’un des obstacles majeurs auxquels s’est partout heurtée l’adaptation des hommes aux conditions d’une économie selon l’ordre capitaliste bourgeois ».
On peut trouver le texte en ligne.

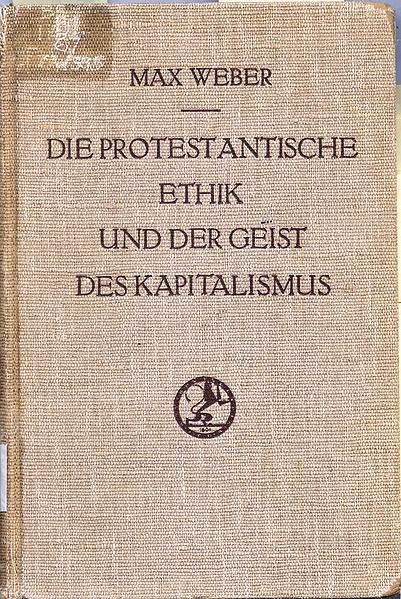

 Follow
Follow