Sans lit, sans fond
la rivière du souffle coule
invisible, sous la grange de brique ancienne,
la demeure du temps.
Ceux qui sont nés dans la boue adamique du Ried
sont voués pour toujours au travail double
du potier et du poète :
pétrir la pâte terrestre, modeler la glaise informe,
et puis germer dans la lumière matinale,
inventer les formes justes qui respirent,
réussir l’insufflation soudaine du vide
au cœur de la tourbe charnelle,
dans cette masse de limon lourde et mouillée,
ruisselante d’une opaque noirceur !
Tout lieu natal est travaillé
par la rivière du souffle
débordant sur l’obscur continent souterrain :
la matrice de l’origine
devient le globe
encore lourdement chthonien,
mais déjà rayonnant,
d’un vase.
Il résonne au milieu du feu
qui le peuple et l’enserre :
espace de musique habitable,
île de terre
ferme, où l’esprit-saint s’est pris soudain au piège
entre les parois rondes et sonores
dont la ténèbre a bu les vibrantes couleurs.
Voici notre maison nouvelle
modelée dans la face humaine :
devant un ciel d’oiseaux tissés dans les nuages,
l’haleine d’un visage.
Heimat des Hauches, endlos
sans rives ni frontières
la rivière du souffle coule
taciturne, sous la chape d’argile crue,
la demeure du sang.
Le corps muet me tourne sur sa roue.
J’habite la maison d’un potier du silence.
Claude Vigée Pâque de la Parole , Flammarion, Paris, 1983
Il serait prétentieux de ma part d’affirmer que je connais l’œuvre de Claude Vigée. Tout au plus quelques textes présents dans des anthologies. Mais j’avais par devers moi, sous le coude, comme on dit, sans trop savoir pourquoi, ce Soufflenheim, cet Heimat des Hauches, expression en allemand traduisant littéralement le titre du poème, cette localité ou demeure du souffle, dans son ancrage idiomatique. D’autres types de questionnements m’y font revenir. Son premier titre était celui de l’expression qui le clôt : Potier du silence. En optant pour le terme qui désigne une localité, il permet de mieux suivre une démarche à partir de ce point de départ qui le mènera au devenir potier du silence Il me permet une réflexion sur la localité et tout ce qu’elle peut contenir de réel et virtuel, d’idiomes et de symbolismes. Dans un contexte où la globalisation est de plus en plus destructrice de localité comme de toute singularité donnant aux habitants de la terre le sentiment que le sol se dérobe sous leurs pieds, nous appelant à nous mettre en position de reconquête de souffle, de localité, de singularité, de parole.
D’abord quelques mots sur son auteur.
A la conquête de la parole
« Claude Vigée, né Claude Strauss à Bischwiller (Bas-Rhin) le 3 janvier 1921, est issu d’une famille juive établie en Alsace depuis plus de trois siècles. Sa première langue fut le dialecte alsacien de son lieu natal. Le judéo-alsacien, dans sa famille qui appartenait à la petite bourgeoisie déjà très assimilée, était quasiment oublié, renié, mais grâce à son grand-père maternel de Seebach, l’enfant apprit encore cet ancien idiome de nos communautés hébraïques, à peu près complètement perdu aujourd’hui. Quant au français, il n’était qu’une patriotique et occasionnelle « langue du dimanche ». Il allait être la langue de l’école. Si l’expérience première du français fut pour l’enfant celle d’un « ravissement » (chansons apprises à la salle d’asile [école maternelle], langue-musique dont il ne comprenait pas le sens), elle ne tardait pas à être marquée brutalement par la contrainte scolaire. Désormais, e Hààs était un lapin : découverte d’un monde nouveau et incertitude première sur l’adéquation du langage et des choses. Qu’est-ce que le vrai nom? Tel fut le traumatisme initial, caractéristique de l’enfance alsacienne. Précisons : ce n’est pas le bilinguisme que le poète met ici en cause, c’est l’interdit jeté sur l’une des langues, sur la langue première, méprisée, rejetée, frappée d’inanité ; c’est le mutisme alsacien, l’alinguisme. L’histoire du poète sera celle d’une difficile conquête de la parole.
(Andrien Finck : Lire Claude Vigée Langue et culture régionales N°14 CNDP-CRDP Académie de Strasbourg)
Je ne suis pas sûr que le terme alinguisme soit ici adéquat. Outre le fait que l’on n’en trouve pas de définition, il suggère une absence de langue là où il est question du b.a-ba, de balbutiements, de ce que Vigée nomme pré-langage. Ne devrait-on pas parler plutôt ce qui fait défaut ou de manque au sens d’Edouard Glissant cité par Derrida dans Le monolinguisme de l’autre ?
« Le « manque » n’est pas dans la méconnaissance d’une langue (le français), mais dans la non-maîtrise d’un langage approprié (en créole ou en français). L’intervention autoritaire et prestigieuse de la langue française ne fait que renforcer les processus du manque ».
Claude Vigée parle d’infirmité linguistique et de perturbation du sens des mots dès l’apprentissage imposé au petit dialectophone du premier mot en français. La langue de l’école apparaît d’abord comme irréelle :
« Une foule de lapins couraient autour de la ville, dans le Ried très sablonneux. Voilà qu’on nous apprenait que le vrai nom du Hààs, c’était lapin… Tout cela ne me semblait pas clair. Qu ‘est-ce que le vrai nom ? Y a-t-il un vrai nom ?… Depuis toujours nous savions le nom de cet animal-là, qu’on voyait courir dans les champs…
Voilà qu’il avait deux noms – donc aucun qui fût véridique, et qu’à son propos un doute surgissait sur tous les noms de personnes et des choses…
Je me sentais déjà infirme-né de la parole… »
(Claude Vigée Le Parfum et la Cendre, Grasset, Paris, 1984)
Claude Vigée dira même avoir été porteur d’ interdit linguistique. Mais même cette crise de la parole a ses avantages en ce qu’elle est une école du silence, avec un vocabulaire réduit à l’essentiel débarrassé du blabla mondain. En même temps, ce prélangage dialectal doit être préservé, il ne devient étouffant que quand on s’y limite :
« Patois et dialectes, reliquats d’une existence proche du sol natal, sont de bonnes écoles de silence. On y fait, mieux qu’en Sorbonne ou dans les cocktails des grands éditeurs parisiens, l’expérience originelle de l’être-au-monde humain. Cette réalité première affleure, avec une peine et une lourdeur qui sont l’indice de l’authenticité, dans notre dialecte fruste, pauvrement articulé, au vocabulaire réduit à l’essentiel (c’est-à-dire à l’immédiat quotidien), inapte à la formulation de toute notion abstraite. Langage de la présence : à peine un langage en somme… Dans la période où se forme l’esprit, nous sommes affligés là d’une sorte de pré-langage, enfantin par nature, qui conserve à travers la désignation naïve du visible, un reste de leur dignité première aux choses d’ici-bas. L’usage de ce dialecte dans nos jeunes années nous marque au sceau de l’inachevé, de l’informe, qui est aussi celui de l’origine vitale et du devenir indéterminé, béants sur l’avenir. (…) » Vue dans cette perspective inhabituelle, la situation du poète alsacien d’expression française, si difficile à tant d’égards – ce serait aveuglement ou mauvaise foi de le nier – comporte peut-être de grands avantages intérieurs. Son manque total de moyens à l’origine, sa longue paralysie expressive due à la carence des éléments fondamentaux du langage, la lutte qu’il doit soutenir au départ contre le mutisme dans l’ordre de l’art, ces douteuses richesses négatives peuvent, s’il ose en saisir le sens spirituel, dur mais purifiant, lui servir un jour de garantie, de vérité humaine et poétique. Il sera moins tenté de se payer de mots, car il les aura gagnés chèrement sur un exil linguistique complet – le dialecte étant, plutôt qu’une autre langue, l’absence de toute langue adulte capable d’exprimer la condition humaine – en renversant des obstacles à première vue insurmontables. Un mot qui est d’abord vécu en creux, comme une souffrance et un combat acharné, ne sera pas galvaudé à la façon d’un héritage gratuit. Le langage nouveau, ainsi conquis sur le silence, comptera, au lieu de conter seulement. (…) Par un apparent paradoxe, le succès de cette tentative originale dépend de la conservation du dialecte en nous-mêmes. Il nous faut à tout prix garder la maîtrise de ce pré-langage, étouffant pour qui s’y limite, providentiel si l’on en tire force et subsistance pour de plus hautes métamorphoses. Il est notre instrument original de plongée dans l’être et constitue, de ce seul fait, un héritage irremplaçable. En même temps, nous ferons bien de briser ses bornes étroites, de transposer les ressources qu’il nous procure dans la sphère d’un langage adulte et suffisamment articulé pour dire le tout de l’expérience humaine.
Vigée La lune d’hiver, Flammarion, Paris, 1970
Claude Vigée appelle langue adulte, ce que E.Glissant qualifie de langage approprié. Il faut pour l’acquérir renverser les obstacles qui y mènent sans renier pour autant le langage de l’enfance, la langue maternelle. Indépendamment de ce dernier aspect, l’idée de langue adulte reste d’une grande actualité devant son infantilisation en particulier par le marketing.
Un dernier mot sur le choix du pseudonyme utilisé par Claude Strauss dans la résistance au sein de l’armée juive toulousaine et qui deviendra son nom de poète : « ‘Hay-Ani » ! Vie j’ai, Vigée.
La demeure du souffle
Passons à la lecture du poème. Soufflenheim est le nom d’un village – au demeurant à la fois artisanal mais en fait quasi industriel – bien connu pour sa tradition très ancienne – encouragée en son temps par l’empereur Frédéric Barberousse – et toujours active de poterie. Nous avons dans le poème une configuration sémantique où s’articulent : demeure / Heim / pays natal / Heimat ( à l’origine composé de Heim et du suffixe at) sans qu’aucun de ces mots issus de divers idiomes ne soit équivalent à l’autre. Ils sont intraduisibles. Cette poly-idiomaticité est une source de richesse dont il faut prendre soin.
Claude Vigée commence, à l’aide de bribes de mémoire éparses, à construire une géographie fictive de cette localité que l’on pourrait écrire avec Bernard Stiegler local-ité 1 c’est à dire qui a le caractère du local sans en avoir forcément une inscription physique, c’est à dire qui tient lieu de, comme l’on dit1. Et à partir duquel peut se conquérir la singularité de la parole et de la pensée. Peut importe que sa topographie soit une construction fictive, l’important est qu’il ne se referme pas sur lui-même mais reste un milieu ouvert comme l’est un Ried. A défaut d’une telle ouverture, on finit comme le chou à choucroute en fermentation anaérobie. Et dans son propre jus. Dans cette localité passe une rivière. Elle n’existe pas réellement comme rivière, elle n’a plus de lit, pas de fond, elle est invisible. Il y en a une bien réelle à quelques kilomètres de là, la Souffel mais elle ne passe pas à cet endroit. Le cours d’eau devient, en jouant de l’ homonymie entre la langue dialectale Soufflenheim et le français : rivière du souffle. Il y ajoute plus loin son expression allemande Heimat des Hauches. En allemand Hauch évoque un souffle plutôt léger voire un soupir. Le mot tient aussi à la fois du vocabulaire de la phonétique (le son de la consonne H) et de la théologie (le souffle de la Création – l’esprit-saint est évoqué dans le texte).
La rivière du souffle passe sous – évente ? – la « demeure du temps » qui est mémoire.
Autre inscription / localisation : la tradition talmudique. Elle préside à l’invention de ce que l’auteur lui-même a appelé Un midrash tout neuf : « À partir d’une étymologie tout imaginaire, en jouant un peu sur les sens, sur les langues, et les racines mêmes des mots, selon la bonne tradition des maîtres talmudiques, je puis donc inventer un midrash tout neuf : il m’a suffi d’évoquer le nom alémanique d’un hameau d’artisans obscurs aux confins de la Basse-Alsace ». Le midrash est au départ une exégèse d’un mot biblique.
Toute localité contient une part d’imaginaire, une virtualité. Sinon on ne comprend pas son attachement à elle (ou sa détestation) surtout quand elle est le lieu de sa première socialisation en lien avec sa langue dite maternelle. Sa dimension virtuelle, symbolique est ce qui permet de l’emporter avec soi. On peut ainsi surprendre parfois l’écho, dans l’oreille, de « ces mots murmurés, que des voix de jadis, depuis longtemps perdues, disaient presque en silence » :
« Ceux qui sont nés dans la boue adamique du Ried »
Le poète procède ensuite à un élargissement de l’espace : de Soufflenheim au Ried. Le choix fait sens dans la mesure où l’on passe de la demeure au milieu2 dont le nom, Ried, évoque une zone peu anthropisée. Son appellation correspond, précise Wikipedia, à une unité paysagère de prairies inondables. Cette zone est assez préservée dans la mesure où de nombreux bras morts du Rhin subsistent, ne permettant pas à ces zones d’être facilement cultivables. Le mot ried a été apporté par les différents dialectes alsaciens et souabes. La prononciation alsacienne de « Ried » est l’équivalent de « Rid » avec un simple i long, parfois très long. Le terme « ried » semble dérivé de l’alémanique « Rieth » qui signifie jonc (roseau). (Wikipedia)
Faisons un petit détour par la bible (Genèse 2:7 dans la traduction de Fréderic Boyer et Jean L’Hour . La bible Fayard)
« YHVH Dieu fabrique un adam poussière
qui vient du sol
souffle la vie dans ses narines
l’adam se met à vivre »
Dieu ensuite plante un jardin.
Le souffle est celui de la vie.
Vigée associe les deux dimensions de la terre ici dans son mélange avec l’eau (boue) et du souffle, ainsi que celles de la création : celle du potier et celle, inséparable, du poète. Au contraire de la vision borgne que conteste Alain Supiot dans un texte qui nous permet en même temps de comprendre ce qu’est cette boue adamique dont parle Claude Vigée :
« Adam, le premier homme des religions du Livre, tire son nom de la terre rouge (adama) avec laquelle Dieu le façonna et le nom de l’homme lui-même vient du latin humus (terre humide) : l’homme c’est celui qui vient de la terre, et qui est destiné à y retourner, à y être inhumé. Né de la terre, il est toutefois animé d’un esprit divin, qui l’autorise à prendre possession d’elle, à la modeler à son image et à la féconder par son labeur. C’est ce second versant – celui de la « prise de terre », de sa prise de possession par le travail ou par les armes – qui a largement dominé l’Occident moderne, au prix d’un refoulement de l’appartenance de l’homme à la terre. Cette vision borgne, dont on peut conjecturer l’origine religieuse, n’aperçoit que l’empreinte de l’homme sur la terre et demeure aveugle à l’empreinte de la terre sur les hommes ».
(Alain Supiot : l’inscription territoriale des lois)
Vigée, me semble-t-il, s’inscrit contre cet abandon, ce refoulement du premier versant. Il parle du travail double du potier et du poète. Il ne sépare pas le travail du souffle ni des divinités telluriques souterraines. De la lourdeur chthonienne naît cependant un objet façonné et « rayonnant ». La poterie non seulement marie l’eau et le feu, elle se situe entre les forces terrestres et le monde céleste. Elle réunit le monde d’en haut et le monde d’en bas. Non sans l’intervention du travail et de la technique du potier. Vigée identifie ce travail à celui du poète.
Adama peut aussi se traduire par glaise. J’ajoute que cette glaise, il ne suffit pas de la prendre pour la façonner, elle n’est pas prête, il faut d’abord selon la parole d’un potier rapportée ici la « domestiquer », c’est à dire la laisser reposer près de la maison car elle est d’origine « sauvage » (wilde erd).
A l’image du potier, le travail du poète sera de faire naître à partir d’une autre matière informe, le silence, une parole. Son vase sera son poème. Il sera – ou plutôt deviendra potier du silence non sans que la demeure du temps de la première strophe ne soit devenue dans la réplique de la dernière demeure du sang, autre référence biblique à la protection contre le fléau destructeur(Exode 12) alors que la langue allemande qui était une langue du pays natal est devenue une langue ennemie. Je rappelle que le poème est paru dans la Pâque de la parole (1983). L’auteur a vécu l’exil, d’abord intérieur dans son propre pays, puis aux Etats-Unis en 1943. Il s’installera en Israël en 1960.
« Heimat des Hauches » vs « Hauch der Heimat » /

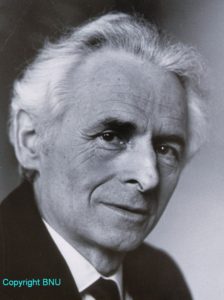

 Follow
Follow