1. « Le rêve de Bismarck »
En 2008, un cinéaste, Patrick Taliercio, en repérage à Charleville, découvrit, dans un exemplaire du «Progrès des Ardennes» daté du 25 novembre 1870 trouvé chez un bouquiniste, un inédit d’Arthur Rimbaud.
Le texte s’intitule « Le rêve de Bismarck ».
Il décrit le chancelier prussien rêvant de conquérir Paris où il se brûle les doigts.
Et le nez.
Il est signé Jean Baudry, pseudonyme d’Arthur Rimbaud.
Ce dernier n’a peut-être jamais su que son texte avait été publié. Les éditions ont été détruites sous les obus qui sont tombés sur Mézières le 31 décembre 1870.
Voici ce texte :
Le rêve de Bismarck
(Fantaisie)
C’est le soir. Sous sa tente, pleine de silence et de rêve, Bismarck, un doigt sur la carte de France, médite ; de son immense pipe s’échappe un filet bleu.
Bismarck médite. Son petit index crochu chemine, sur le vélin, du Rhin à la Moselle, de la Moselle à la Seine ; de l’ongle, il a rayé imperceptiblement le papier autour de Strasbourg : il passe outre.
A Sarrebruck, à Wissembourg, à Woerth, à Sedan, il tressaille, le petit doigt crochu : il caresse Nancy, égratigne Bitche et Phalsbourg, raie Metz, trace sur les frontières de petites lignes brisées, — et s’arrête…
Triomphant, Bismarck a couvert de son index l’Alsace et la Lorraine ! — Oh ! sous son crâne jaune, quels délires d’avare ! Quels délicieux nuages de fumée répand sa pipe bienheureuse !…
Bismarck médite. Tiens ! un gros point noir semble arrêter l’index frétillant. C’est Paris.
Donc, le petit ongle mauvais, de rayer, de rayer le papier, de ci, de là, avec rage, — enfin, de s’arrêter… Le doigt reste là, moitié plié, immobile.
Paris ! Paris ! — Puis, le bonhomme a tant rêvé l’œil ouvert, que, doucement, la somnolence s’empare de lui : son front se penche vers le papier ; machinalement, le fourneau de sa pipe, échappée à ses lèvres, s’abat sur le vilain point noir…
Hi ! povero ! en abandonnant sa pauvre tête, son nez, le nez de M. Otto de Bismarck, s’est plongé dans le fourneau ardent… Hi ! povero ! va povero ! dans le fourneau incandescent de la pipe…, Hi ! povero ! Son index était sur Paris !… Fini, le rêve glorieux !
Il était si fin, si spirituel, si heureux, ce nez de vieux premier diplomate ! — Cachez, cachez ce nez !…
Eh bien ! mon cher, quand, pour partager la choucroute royale, vous rentrerez au palais
(lignes manquantes)
Voilà ! fallait pas rêvasser !
Jean Baudry
NB : « Hi povero » signifie en italien « le pauvre ! ». Peut-être un clin d’œil à Garibaldi ?
Sur le contexte de l’écriture entre la défaite de Sedan et la Commune de Paris) ainsi que sur les circonstances de la découverte de cet inédit, nous renvoyons au dossier du quotidien L’Union de Charleville Mézières.
2. De quoi Bismarck est-il le nom ?
J’esquisse une réponse à la question d’un ami qui me demandait en plaisantant après que j’eus évoqué ce texte : de quoi Bismarck est-il le nom ?
Spontanément, je lui ai dit : c’est le nom de l’indigence de la politique.
Essayons d’approfondir cette intuition.
Evidemment, Angela Merkel n’est pas plus Bismarck que Montebourg n’est Rimbaud.
Que l’on me comprenne bien : ce n’est pas la méchanceté du qualificatif qui me choque. Visait-elle d’ailleurs autre chose qu’une minute de célébrité pour rallier à François Hollande les partisans du non à Maastricht ? Ce qui me choque, c’est la misère de la comparaison là où l’on attendrait une analyse plus pertinente de la politique actuelle de la chancelière allemande, le signe d’un état de réflexion audacieux sur l’Allemagne et l’Europe.
Celles d’aujourd’hui et non celles de la fin du 19ème siècle.
Las ! Au lieu d’une compréhension intelligente de ce qui se passe réellement, on assiste au triste spectacle d’accusations réciproques de germanophobie.
La réaction selon laquelle il ne faudrait prononcer à l’égard de l’Allemagne aucun mot qui fâche n’en est pas moins navrante. Ah bon et pourquoi donc ? Ne pas prendre le risque d’un mot qui fâche revient à refuser de s’interroger sur le fond des choses.
Notre classe politique semble découvrir que l’Europe dans sa dimension communautaire – qui n’est pas la seule – tourne autour de l’Allemagne.
En a-t-il jamais été autrement depuis la fin de la seconde guerre mondiale ?
Angela Merkel prend la succession des politiques d’Adenauer et de Ludwig Erhard. Elle voit dans cette crise la chance de parachever, à l’échelle européenne, l’œuvre ordolibérale faisant comme si rien de fondamental n’avait changé, ignorant la part prise par l’Allemagne dans la crise actuelle comme par exemple un taux de retour sur investissement de 25 % réclamé par la Deutsche Bank. A force de redistribuer du bas vers la haut, l’Allemagne est le pays de l’OCDE dont la fracture sociale s’est le plus aggravée.
Personne n’a-t-il pris la peine de lire le discours de la chancelière devant le Bundestag ?
Que dit-elle ?
La crise est une crise de la dette et une crise de la confiance.
Il existe un domaine qui a, au fil des années, pratiquement perdu tout crédit, c’est la politique.
Sur ce point, elle n’a sans doute pas tort sauf qu’elle ne pense pas à la perte de confiance des populations dans la politique, elle vise la perte de confiance des marchés financiers dans la politique. Et la conclusion qu’elle en tire est que pour préserver la confiance dans les seules institutions dignes de confiance que sont les banques centrales et la Cour de justice européenne, il faut garantir leur indépendance et donc dessaisir la politique de ses attributions budgétaires, institutionnaliser des mécanismes de sanctions contre les états qui ne respecteraient pas la discipline budgétaire.
Il faut faire fi de toute économie politique.
En cela, ce n’est pas du tout une politique bismarckienne mais néolibérale, de « ce libéralisme qui nous vient d’Allemagne » comme le disait Michel Foucault qui souligne que « faire sortir de la véridiction du marché la juridicité de l’Etat, c’est ça le miracle allemand »
Avec tout cela qui existe aussi dans les cartons de la Commission européenne, A. Merkel, à ce qu’elle assure, est en phase avec son homologue français. Ce n’est plus un sujet de discussion mais de mise en musique.
Et si l’on parle, en Allemagne aussi, de guerre ou de putsch, ce n’est pas celui ou celle d’un gouvernement mais celle et celui des marchés financiers.
Contre la démocratie, contre la politique, les Etats, les peuples.
La Frankfurter Allgemeine Zeitung publiait le week-end dernier un essai de Michael Hudson, professeur d’économie à l’Université du Missouri et analyste financier à Wall Street dont le titre anglais est Democracy-and-debt ( Dette et démocratie ) dans lequel il évoque la manière dont la finance internationale mène « une sorte de guerre qui poursuit les mêmes buts que les conquêtes militaires d’autrefois : l’appropriation des terres et des richesses du sous-sol, des infrastructures publiques, la levée de tributs ».
Il ne faudrait pas une fois de plus se tromper de guerre et rater les convergences possibles avec ceux qui en Allemagne aussi réfléchissent.

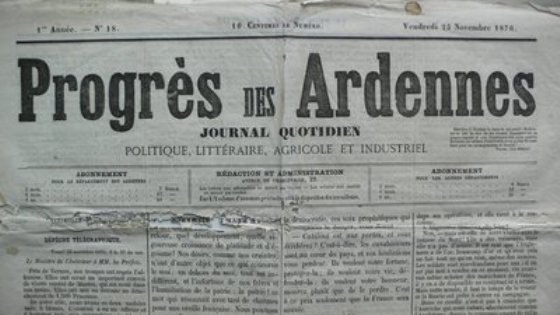
 Follow
Follow
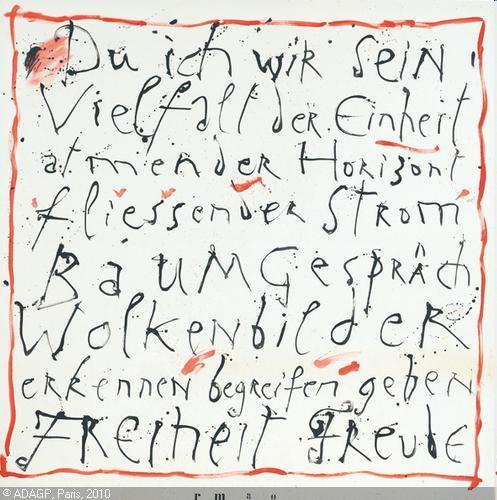

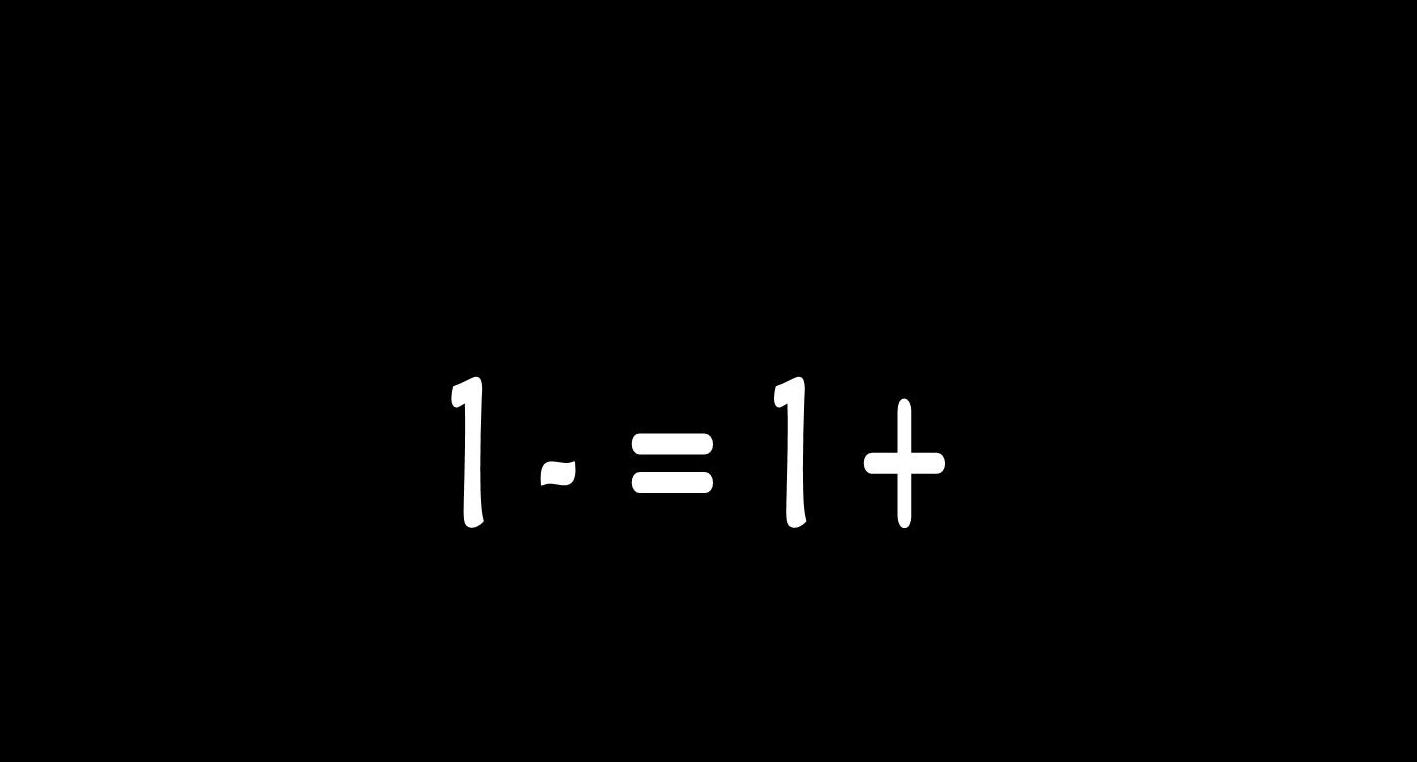


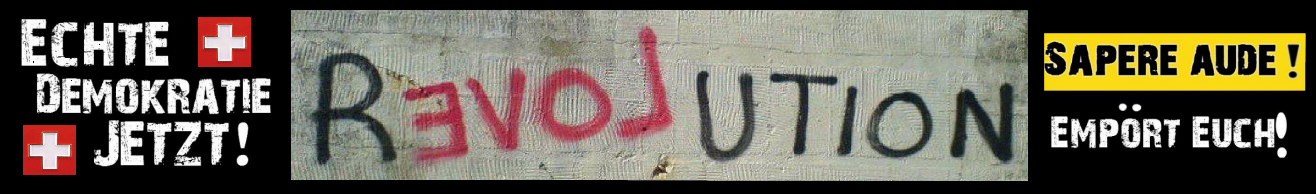
Les tartuffes de la rigueur monétaire
(Foto: Yusuf Beyazit) Le 9 novembre, les premières tentes s'installent à Berlin sur la plage de la presse accréditée auprès des instances fédérales.
Pourquoi la Banque Centrale européenne (BCE) qui octroie aux banques privées autant de crédits qu’elles en demandent à des taux de plus en plus bas pour qu’elles-mêmes en prêtent aux Etats à des taux de plus en plus élevés ne finance-t-elle pas directement les Etats ?
La question n’est pas nouvelle.
Mais si moi, simple citoyen, je la pose, on me renvoie à mon ignorance supposée des questions économiques et financières. Or voici qu’elle est posée par un spécialiste des questions financières, éditorialiste au Financial Times Allemagne (FTD), Lucas Zeise. Il ne se contente pas de poser la question, il y répond par un coup de gueule contre les tartufes de la stabilité monétaire.
En résumé :
LA BCE ne doit pas financer les dettes des Etats, disent les critiques. En vérité, ces Tartufes ne veulent qu’une chose : que les banques privées puissent continuer à gagner de l’argent en servant d’intermédiaires .
Il est heureux – et symptomatique du moment présent – qu’un journaliste financier se lance ainsi. Cela se passe alors que les mouvements, occupy, ou indignés ou réelle démocratie maintenant rejoints depuis peu en Allemagne par Attac et les syndicats avec le soutien de nombreux universitaires économistes posent à leur tour des questions sur le pouvoir des banques.
Les banques privées détiennent le monopole de la création monétaire. Ce pouvoir unique s’accompagne d’une justification : le soupçon permanent que les Etats ont trop de facilité à manier la planche à billet provoquant des risques inflationnistes. La planche à billets privée est, elle, sans limite.
L’éditorialiste du FTD écrit :
La Banque centrale, dans notre système monétaire, finance l’Etat régulièrement et de manière tout à fait ordinaire. Mais elle le fait par le biais d’’intermédiaires puisque c’est ainsi que se nomment les banques chez qui reste l’essentiel des bénéfices réalisés. L’interdiction faite à la Banque centrale de financer les Etats devrait, pour rendre justice à la pratique actuelle, être formulée ainsi : La Banque centrale ne peut financer les institutions de l’Etat qu’en assurant une participation des banques privées aux bénéfices .
Lucas Zeise traite d’hypocrites les dévots allemands de la stabilité monétaire. Sont nommément désignés Otmar Issing, ex-chef économiste de la BCE passé chez Goldman Sachs, Axel Weber, ancien président de la Deutsche Bank passé chez UBS, et Jens Weidmann, actuel président de la Deutsche Bank. « Leur cri de guerre, écrit-il, jamais la Banque centrale ne doit activer la planche à billets signifie en réalité les bénéfices doivent toujours atterrir dans les banque privées. »
Admettons que l’on réussisse à vaincre la résistance de ces faux dévots et de leur nombreux soutiens dans les banques et dans les medias, admettons que la BCE prenne à grande échelle dans son bilan les dettes des Etats européens, en résulterait-il une augmentation massive de la masse monétaire, aurions-nous à craindre une inflation galopante comme dans le Reich allemand des années 1919 et suivantes, lorsque les coûts de la guerre ont été monétarisés ? Rien de tout cela.
Il est intéressant de noter que dans sa conclusion notre auteur signale que cette question seule ne suffit pas à résoudre la crise : « Alors que le secteur financier et les rentiers sont financés par la BCE à travers les budgets de l’Etat, l’économie réelle stagne. Sans changement radical dans la distribution des revenus, les perspectives restent sombres »
Peut-être que l’éditorialiste du Financial Times a des intentions que je ne perçois pas. Peu importe. On ne pourra plus dire que ma question est idiote. On ne pourra plus me dire que je n’y comprends rien.
Au début du siècle dernier, le mot d’ordre en Russie était tout le pouvoir aux soviets. Depuis la chute du Mur de Berlin et la fin de L’Union soviétique, il semble que le mot d’ordre soit en Europe : tout le pouvoir aux banques. Selon le quotidien espagnol El Mundo, le politburo de ce nouvel ordre existe déjà.
Le quotidien rapporte en effet que le sommet du G20 de Cannes a vu la naissance d’un nouveau « lobby politico-économique »: le Groupe de Francfort (GdF), qui serait composé de huit personnalités :
La chancelière allemande Angela Merkel, le président français Nicolas Sarkozy, devenus de plus en plus les ‘Merkozy’ dans la presse européenne. Mais aussi Jean-Claude Juncker, président de l’Eurogroupe, Christine Lagarde, directrice du FMI, José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, Mario Draghi, président de la BCE, et Olli Rehn, commissaire aux Affaires économiques et monéraire. Le groupe est né par hasard dans l’ancien opéra de Francfort le 19 octobre dernier, où ces dirigeants assistaient aux adieux de Jean-Claude Trichet comme président de la BCE.
Selon El Mundo, les plus critiques appellent le GdF ‘politburo’ par son absence de légitimité démocratique. Ils lui attribuent la décapitation de Georges Papandréou [et probablement la nomination du successeur] et le coup de poignard à Silvio Berlusconi [et le choix de son successeur]. Ses défenseurs, de leur côté, donnent au groupe le statut d’antidote nécessaire pour mettre un terme à la crise de l’euro.
Articles liés :
Des « je » à la recherche d’un « nous »
Dans l’ivresse des zéros….
En Allemagne aussi…et en Suisse
Il s’est passé quelque chose, ce samedi 15 octobre 2011
Rendez-nous le marché ordolibéral