Que se tiennent encore des grands messes pour célébrer le culte de l’automobile témoigne certes de la persistance de cette religion dans la culture mais masque mal en même temps qu’il en va de cette religion comme des autres, elles sont en déclin. C’est toute l’ambigüité de l’exposition Fetisch Auto. Ich fahre also bin ich (Auto fétiche /je conduis donc je suis) qui se tient actuellement au Musée Tinguely de Bâle. Un journaliste suisse a présenté l’exposition comme ceci : Ou quand l’idée de la voiture est soudain à mille lieues de la futilité égocentrique et polluante à laquelle d’aucuns la confinent. (Bernard Léchot, swissinfo.ch Bâle). Peu importe cependant que ce soit là le but de l’expo, tout indique en effet que c’est le cas, l’intéressant est que l’on peut la voir autrement.
Objet technique et de désir, la voiture n’est plus ni l’un ni l’autre. A part la mort qui l’accompagne depuis ses débuts, elle n’a tenu aucune de ses promesses.
En qualifiant l’automobile de cathédrale démocratisée de notre époque (il a fait baptiser une Citroën déesse), Roland Barthes n’a pas réussi l’une des meilleures comparaisons. Mais elle a fait école. L’espace d’exposition au Musée Tinguely est organisé comme un lieu de culte circulaire (la voiture ne sert plus qu’à tourner en rond) autour de l’œuvre de l’artiste mexicain Damian Ortega intitulée Cosmic Thing (objet co(s)mique), pièces détachées suspendues d’une Coccinelle, voiture qui avait été créée à la demande d’Hitler par Volkswagen et que l’on connaît désormais sans doute plus au Mexique qu’en Europe. Cela ressemble à ces jouets, modèles réduits à construire qu’on offre aux enfants pour leur catéchisme automobile (Je ne m’exclus pas, je l’ai fait moi-aussi).

Autour du Chœur, les chapelles absidiales dédiées à la vitesse, à l’accident, à divers courants artistiques (pop art, nouveau réalisme, futurisme) et aux différents fétichismes (marchand, religieux, sexuel). Au sous-sol, dans la crypte, les sépultures, mausolées, danses macabres, œuvres de Jean Tinguely lui-même, grand amateur de courses automobiles. Elles sont de mon point de vue ce qui reste de plus impressionnant.
Avant de poursuivre, un petit aparté pour une comparaison avec la cathédrale comme bâtiment.
 La Manufacture de verre des usines Volkswagen à Dresde est une cathédrale de verre à la gloire du Dieu automobile. On y célèbre la voiture comme un objet d’idolâtrie. Chaque client d’une Phaeton (nous sommes là dans la mythologie grecque) peut assister en direct au montage et à la finition de sa propre voiture. Dans le film de présentation, Volkswagen affiche l’ambition d’égaler les constructions baroques de Dresde et célèbre la voiture comme une œuvre de Richard Wagner ! Le lieu se veut lui-même espace culturel, d’exposition de peinture, de défilés de mode, de présentation d’opéra. Derrière les vitres défilent les chaines de montage. C’est comme le suggèrent les projecteurs une véritable mie en scène du travail de fabrication d’une voiture.
La Manufacture de verre des usines Volkswagen à Dresde est une cathédrale de verre à la gloire du Dieu automobile. On y célèbre la voiture comme un objet d’idolâtrie. Chaque client d’une Phaeton (nous sommes là dans la mythologie grecque) peut assister en direct au montage et à la finition de sa propre voiture. Dans le film de présentation, Volkswagen affiche l’ambition d’égaler les constructions baroques de Dresde et célèbre la voiture comme une œuvre de Richard Wagner ! Le lieu se veut lui-même espace culturel, d’exposition de peinture, de défilés de mode, de présentation d’opéra. Derrière les vitres défilent les chaines de montage. C’est comme le suggèrent les projecteurs une véritable mie en scène du travail de fabrication d’une voiture.
Retour à Bâle. Comme nous venons de le voir dans l’exemple précédent, autour de l’automobile se cristallise le lien étroit entre Art et Capital. Il s’opère entre les deux – et pas seulement à travers la peinture et la sculpture- des transferts d’images, comme le souligne dans le catalogue de l’exposition Tinguely, Hartmut Böhme. Pour cet auteur, professeur d’esthétique et d’histoire des mentalités à l’Université Humboldt de Berlin, l’automobile, objet de culte central de la modernité est “un artefact dans lequel se synthétise de la manière la plus évidente l’esprit du capitalisme et les énergies de notre culture”. La difficulté de cette thèse réside principalement dans sa temporalité : le présent de cette affirmation ne fonctionne plus. C’est encore plus vrai pour le futur. Aussi bien l’esprit du capitalisme que les énergies de notre culture sont en crise. C’est précisément une époque où la voiture symbolisait les années glorieuses du capitalisme consumériste qui s’achève alors qu’elle est ici considérée comme pérenne.
Non que l’automobile disparaisse de notre quotidien mais son statut d’objet de désir est pour le moins émoussé. La question de l’automobile n’est pas seulement celle du pétrole et des gaz à effet de serre. Si l’avenir n’appartient pas à la voiture individuelle fut-elle électrique mais au partage sous ses formes diverses, c’est aussi parce que l’auto-mobile est de plus en plus inutilement une auto-immobile. La voiture passe 90 % de son temps à l’arrêt, le reste dans les embouteillages ou à tourner en rond à la recherche d’un parking. Ces réalités ne semblent pas encore perçues outre-Rhin. Ceci explique sans doute cela, tous les auteurs du catalogue sont issus de pays de langue allemande où l’on est écologiste à 100% mais … en voiture.
Qu’en est-il des promesses de mobilité, d’ivresse et de liberté de l’accouplement homme-voiture ? Je ne ferai pas un compte-rendu exhaustif de toutes les salles. Je m’arrêterai sur trois d’entre elles dont on peu regretter qu’elles soient séparées ; celles consacrées au futurisme, à la vitesse et à l’accident. L’accident n’est pas le contraire de la vitesse, il est l’accident de la vitesse.
 Giacomo Balla Velocità d’automobile, 1913.
Giacomo Balla Velocità d’automobile, 1913.
Les Futuristes ont sacralisé la “vitesse divine”(Marinetti) et partant la mort qui l’accompagne et la guerre qui est son essence. Le Futurisme ne relève que d’un seul art, celui de la guerre et de son essence, la vitesse, écrit Paul Virilio (Vitesse et politique Editions Galilée 1977)
Avec l’accident, le théâtre est dans la rue (titre d’une œuvre du sculpteur allemand, Wolf Vostell), ce que la littérature aura également observé. L’écrivain autrichien Robert Musil est l’un des premiers sinon le premier à avoir décrit dans un roman un accident automobile, du début à la fin, dès les premières lignes de son roman inachevé L’homme sans qualité. Un texte plein d’ironie. Nous sommes en Août 1913, à Vienne :
Les deux personnes dont je parle s’arrêtèrent tout à coup à la vue d’un attroupement. Un instant auparavant, déjà, quelque chose avait dévié, en mouvement oblique; quelque chose avait tourné, dérapé: c’était un gros camion, freiné brutalement, ainsi qu’on pouvait le voir maintenant qu’il était échoué là, une roue sur le trottoir. Aussitôt, comme les abeilles autour de l’entrée de la ruche, des gens s’étaient agglomérés autour d’un petit rond demeuré libre. On y voyait le chauffeur descendu de la machine, gris comme du papier d’emballage, expliquer l’accident avec des gestes maladroits. Les gens qui s’étaient approchés fixaient leurs regards sur lui, puis les plongeaient prudemment dans la profondeur du trou où un homme, qui semblait mort, avait été étendu au bord du trottoir. L’accident était dû, de l’avis presque général, à son inattention. L’un après l’autre, des gens s’agenouillaient à côté de lui, voulant faire quelque chose; on ouvrait son veston, on le refermait, on essayait d’asseoir le blessé, puis de le coucher de nouveau; on ne cherchait, en fait, qu’à occuper le temps en attendant que Police-secours apportât son aide autorisée et compétente.
Le schéma est depuis classique dans sa chronologie : le dérapage, l’accident, l’attroupement des curieux, l’arrivée des secours. Mais l’accident met mal à l’aise. On est en demande d’une explication “rationnelle”.
La dame et son compagnon s’étaient approchés eux aussi et, par-dessus les têtes et les dos courbés, avaient considéré l’homme étendu. Alors, embarrassés, ils firent un pas en arrière. La dame ressentit au creux de l’estomac un malaise qu’elle était en droit de prendre pour de la pitié; c’était un sentiment d’irrésolution paralysant. Après être resté un instant sans parler, le monsieur lui dit:
« Les poids-lourds dont on se sert chez nous ont un chemin de freinage trop long. »
La dame se sentit soulagée par cette phrase, et remercia d’un regard attentif. Sans doute avait-elle entendu le terme une ou deux fois, mais elle ne savait pas ce qu’était un chemin de freinage et d’ailleurs ne tenait pas à le savoir; il lui suffisait que l’affreux incident pût être intégré ainsi dans un ordre quelconque, et devenir un problème technique qui ne la concernait plus directement.
Phrase admirable : Les poids-lourds dont on se sert chez nous ont un chemin de freinage trop long. On n’y comprend rien mais l’apparente technicité du propos fait figure d’explication rationnelle qui soulage. Ainsi les choses sont à nouveau en ordre.
Du reste, on entendait déjà l’avertisseur strident d’une ambulance, et la rapidité de son intervention emplit d’aise tous ceux qui l’attendaient. Ces institutions sociales sont admirables. On souleva l’accidenté pour l’étendre sur une civière et le pousser avec la civière dans la voiture. Des hommes, vêtus d’une espèce d’uniforme, s’occupèrent de lui, et l’intérieur de la machine, qu’on entr’aperçut, avait l’air aussi propre et bien ordonné qu’une salle d’hôpital. On s’en alla, et c’était tout juste si l’on n’avait pas l’impression, justifiée, que venait de se produire un événement légal et réglementaire.
L’explication technique est complétée par les données statistiques, statistiques dont les spécialistes de Musil ont montré qu’elles sont totalement fausses, ce qui renforce le propos. Car peu importe que les statistiques soient fausses pourvu qu’il y en ait.
D’après les statistiques américaines, remarqua le monsieur, il y aurait là-bas annuellement 90000 personnes tuées et 450 000 blessées dans des accidents de circulation.
Maintenant que nous sommes rassurés, il est peut-être temps de s’interroger sur la victime.
– Croyez-vous qu’il soit mort? demanda sa compagne qui persistait dans le sentiment injustifié d’avoir vécu un événement exceptionnel.
– J’espère qu’il vit encore, répliqua le monsieur. Quand on l’a porté dans la voiture, ça en avait tout l’air. »Robert Musil : L’homme sans qualité T1 (Editions du Seuil Points pages 11-14)
Le philosophe Ernst Bloch notait qu’après les frayeurs de leur première apparition, les révolutions techniques perdaient leur “caractère démoniaque” et que l’accident en était le rappel.
En fait, la vitesse visible de la substance – celle des moyens de transport, de calcul, ou d’information – n’est jamais que la partie émergée de l’iceberg de la vitesse invisible, celle-là, de l’ACCIDENT, et ceci aussi bien dans le domaine de la circulation routière que dans celui de la circulation des valeurs.Paul Virilio : L’accident originel (Editions Galilée 2005)
Passons dans la crypte, à l’étage en dessous, entièrement dédiée aux danses macabres de Jean Tinguely, grand amoureux de courses automobiles et ami des pilotes de course.
Les œuvres présentes mettent en scène le rapport entre l’automobile et la mort : la faucheuse dans le Safari de la mort moscovite (un gros plan ci-dessous), la Charrette de la terreur, La Lotus (de Jim Clark) associée aux 5 veuves d’Eva Aeppli, installation que Tinguely avait placé dans sa chambre à coucher après la mort du plote de Formule 1 Jo Siffert, Lola T 180 – Mémorial pour Joachim B.
 Le sous titre de l’exposition, Je conduis, donc je suis, amusante dans les embouteillages devient ici : je conduis et je cesse d’être.
Le sous titre de l’exposition, Je conduis, donc je suis, amusante dans les embouteillages devient ici : je conduis et je cesse d’être.
Plus d’infos sur l’exposition
 Un pan de mur PotsdamerPlatz à Berlin avec l’effigie de Rosa Luxemburg. La dernière fois que j’y suis passé, elle n’y était plus.
Un pan de mur PotsdamerPlatz à Berlin avec l’effigie de Rosa Luxemburg. La dernière fois que j’y suis passé, elle n’y était plus.
 Follow
Follow

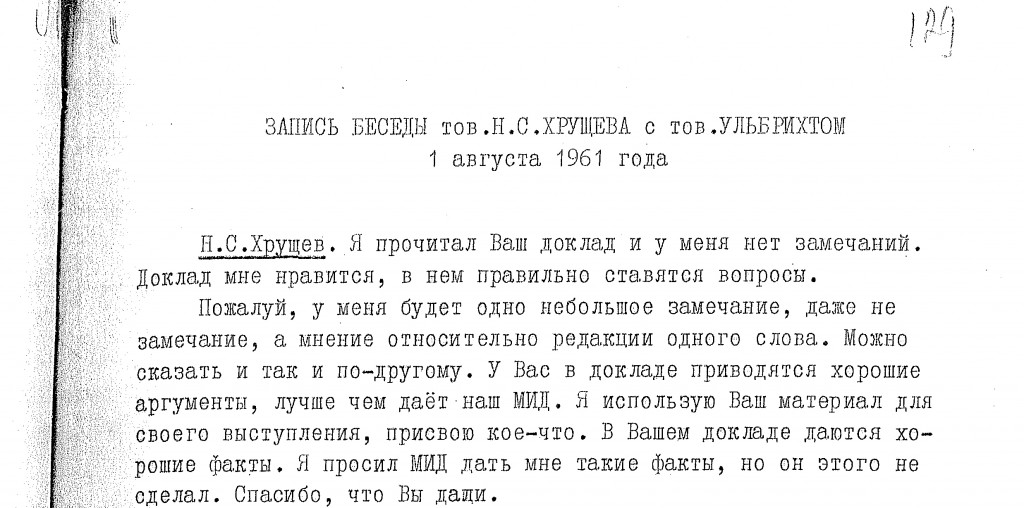
 Le dispositif technique de vol mis au point par Albrecht Ludwig Berblinger, tel qu’il a été reconstitué pour les besoins du film que lui a consacré Edgar Reitz., présenté ici dans l’exposition Décollage. La vision du vol à ULM
Le dispositif technique de vol mis au point par Albrecht Ludwig Berblinger, tel qu’il a été reconstitué pour les besoins du film que lui a consacré Edgar Reitz., présenté ici dans l’exposition Décollage. La vision du vol à ULM










L‘Allemagne s’engage-t-elle dans la 3ème révolution industrielle ?
Dans le Journal du Dimanche (5 juin 2011), la présidente d’Areva s’exprimait sur la décision allemande de sortir du nucléaire en ces termes :
Ce n’est jamais que l’application d’une décision prise par Gerhard Schröder en 2002. Angela Merkel a fait une brusque volte-face pour des raisons politiques. Le reste de l’Europe réagit différemment. Deux exemples ces dix derniers jours: la Grande-Bretagne a annoncé le maintien de son programme nucléaire ; le Parlement polonais vient de voter le sien à 90%. Les fondamentaux n’ont pas changé: nous serons 3 milliards de plus d’ici à 2050 ; il va falloir trouver beaucoup plus d’énergie la moins chère possible ; enfin, il va falloir rejeter beaucoup moins de CO2. Or les deux types d’énergie ne produisant pas de CO2 sont les renouvelables et le nucléaire. Par quoi l’Allemagne va-t-elle remplacer son nucléaire? Du charbon? Du gaz? ça veut dire plus de CO2 ! Des énergies renouvelables? Elles sont intermittentes et on ne sait pas stocker l’électricité. L’Allemagne devra donc importer de l’électricité venue de pays ayant tous des programmes nucléaires. Où est la logique?
Nous allons essayer de répondre à la question de Mme Anne Lauvergeon en nous étonnant que dans un groupe comme Areva, elle ne dispose pas des ressources en interne pour une analyse plus fine de ce qui se passe en Allemagne. A moins bien sûr qu’elle ne considère que les lectrices et lecteurs du JDD ne méritent pas mieux que la plus plate propagande pour empêcher qu’un débat ne se déploie en France. La tentative nous fait perdre beaucoup de temps. Mieux vaudrait peut-être considérer qu’il faut éviter de se laisser par trop distancer par l’Allemagne.
Reprenons point par point Continuer la lecture →